 “What a journey”, probably the thought that crosses our minds the most in the aftermath of our Manfred Lachs Moot Court experience, well, next to key-tips like “embrace the questions”, “no stress” and “not too fast”, but we’ll get to that later. While this journey only started in earnest at the end of the first semester, when we were selected to represent the ULB in the international competition, we first became acquainted with the case during the first semester pleading course. Did we think we had already obtained a nice grasp of the case back then? Yes. Did we quickly realize how little we had thought of until that time? Yes as well.
“What a journey”, probably the thought that crosses our minds the most in the aftermath of our Manfred Lachs Moot Court experience, well, next to key-tips like “embrace the questions”, “no stress” and “not too fast”, but we’ll get to that later. While this journey only started in earnest at the end of the first semester, when we were selected to represent the ULB in the international competition, we first became acquainted with the case during the first semester pleading course. Did we think we had already obtained a nice grasp of the case back then? Yes. Did we quickly realize how little we had thought of until that time? Yes as well.
But don’t let that scare you, no matter whether you have studied international law for a few years or have only seen the basics, knowledge of international law, while useful, is only part of the story. Rather, it’s endurance, the willingness to go on, to keep on studying, writing and researching, both alone and as a team, that is both your primary asset during a moot court as well as a skill you’ll learn to develop even further. Believe us when we say, you’ll never be idle for long during a moot court year.
On that account, the Manfred Lachs International Law Moot Court, like any other moot court competition has two parts: writing the memorials and performing the oral pleadings. The Lachs competition equally offers the additional challenge of framing its facts in a space law context, even if the many problems themselves are often of a more general nature, from questions on sources to solving problems via analogies. More practically, a moot court is an excellent exercise to make a transition from a more academic style of writing to a more demonstrative style fit for a later life at the bar or elsewhere. Continuer la lecture
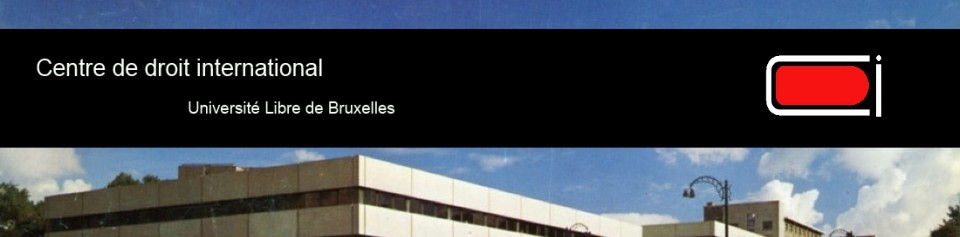
 Arthur Fallas, avocat et assistant chargé d’exercices en droit international, fera une présentation le 17 juin prochain intitulée « Droit de l’espace : le bilatéralisme comme solution au principe de non-appropriation des corps célestes? ». La présentation aura lieu de 12h à 14h dans l’espace virtuel Teams et si vous désirez la suivre, vous pouvez vous inscrire auprès de Chérifa Saddouk (cdi@ulb.be).
Arthur Fallas, avocat et assistant chargé d’exercices en droit international, fera une présentation le 17 juin prochain intitulée « Droit de l’espace : le bilatéralisme comme solution au principe de non-appropriation des corps célestes? ». La présentation aura lieu de 12h à 14h dans l’espace virtuel Teams et si vous désirez la suivre, vous pouvez vous inscrire auprès de Chérifa Saddouk (cdi@ulb.be).
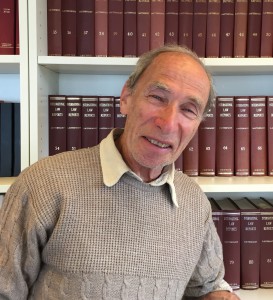
 Un nouvel ouvrage, intitulé Cinematic Perspectives on International Law, vient de paraître aux éditions Manchester University Press. L’ouvrage, co-dirigé par Olivier Corten et François Dubuisson avec l’assistance de Martyna Fałkowska-Clarys, reprend certaines des études parues dans le livre publié en 2015 aux éditions Pedone – Du droit international au cinéma -, études qui ont été entièrement refondues et actualisées. Il comprend aussi de nouvelles contributions de Nicolas Kang-Riou, Gabrielle Simm, Mario Prost et Gerry Simpson. Tous les détails à propos de cet ouvrage peuvent être obtenus
Un nouvel ouvrage, intitulé Cinematic Perspectives on International Law, vient de paraître aux éditions Manchester University Press. L’ouvrage, co-dirigé par Olivier Corten et François Dubuisson avec l’assistance de Martyna Fałkowska-Clarys, reprend certaines des études parues dans le livre publié en 2015 aux éditions Pedone – Du droit international au cinéma -, études qui ont été entièrement refondues et actualisées. Il comprend aussi de nouvelles contributions de Nicolas Kang-Riou, Gabrielle Simm, Mario Prost et Gerry Simpson. Tous les détails à propos de cet ouvrage peuvent être obtenus 


 Le Centre de droit international de l’ULB engage un.e assistant.e à temps plein pour un mandat de deux ans (renouvelable deux fois). Ce mandat inclut des tâches de recherche consistant à réaliser une thèse de doctorat dans le domaine du droit international public, des tâches pédagogiques ainsi que des tâches logistiques. Concernant les tâches pédagogiques plus particulièrement, l’assistant.e devra prendre en charge des groupes de travaux pratiques à concurrence de minimum 120 h/an (face à l’étudiant) et devra aussi accomplir des activités de service à la Faculté et l’Université (surveillance d’examens, participation à des commissions, etc.). Le délai pour introduire une candidature est fixé au 10 mai 2021 et l’entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2021.
Le Centre de droit international de l’ULB engage un.e assistant.e à temps plein pour un mandat de deux ans (renouvelable deux fois). Ce mandat inclut des tâches de recherche consistant à réaliser une thèse de doctorat dans le domaine du droit international public, des tâches pédagogiques ainsi que des tâches logistiques. Concernant les tâches pédagogiques plus particulièrement, l’assistant.e devra prendre en charge des groupes de travaux pratiques à concurrence de minimum 120 h/an (face à l’étudiant) et devra aussi accomplir des activités de service à la Faculté et l’Université (surveillance d’examens, participation à des commissions, etc.). Le délai pour introduire une candidature est fixé au 10 mai 2021 et l’entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2021.