
Lors de la session d’Angers qui s’est déroulée au mois d’août dernier, Olivier Corten, auparavant membre associé a été désigné membre titulaire de l’Institut de droit international.
https://www.idi-iil.org/fr/membres/corten-olivier/


Lors de la session d’Angers qui s’est déroulée au mois d’août dernier, Olivier Corten, auparavant membre associé a été désigné membre titulaire de l’Institut de droit international.
https://www.idi-iil.org/fr/membres/corten-olivier/
 L’ULB vient de décerner ses Prix de la diffusion scientifique 2023, récompensant des chercheurs, chercheuses ou collectifs de recherche qui ont contribué au cours de l’année à partager leur démarche et leurs connaissances scientifiques avec le grand public.
L’ULB vient de décerner ses Prix de la diffusion scientifique 2023, récompensant des chercheurs, chercheuses ou collectifs de recherche qui ont contribué au cours de l’année à partager leur démarche et leurs connaissances scientifiques avec le grand public.
Anne Lagerwall a obtenu le prix dans la catégorie « éditions digitale ou papier », pour sa chronique mensuelle dans Le Vif intitulée ‘A la marge’ dans laquelle elle décrypte l’actualité internationale à l’aide d’une approche (critique) du droit international. Toutes les informations au sujet de ces prix peuvent être consultées ici.
 Le Centre de Droit International a le plaisir de vous inviter au prochain Midi du Centre qui se tiendra le mardi 12 décembre 2023, à 12h15 et qui aura pour thème : « L’applicabilité du droit international des droits humains aux procédures de visas humanitaires ». La présentation sera assurée par Eugénie DELVAL, Doctorante, aspirante FNRS, au Centre de droit international, sous la direction de François Dubuisson.
Le Centre de Droit International a le plaisir de vous inviter au prochain Midi du Centre qui se tiendra le mardi 12 décembre 2023, à 12h15 et qui aura pour thème : « L’applicabilité du droit international des droits humains aux procédures de visas humanitaires ». La présentation sera assurée par Eugénie DELVAL, Doctorante, aspirante FNRS, au Centre de droit international, sous la direction de François Dubuisson.
Pour rappel, les Midis du Centre de Droit International se déroulent dans la salle de réunion du Centre de Droit International (6, Av. Paul Héger, 1050 Bruxelles, Bâtiment H, 5ème étage, local H5.159). L’inscription est obligatoire via ce formulaire.
Des sandwiches seront offerts aux participant·es qui le souhaitent sous réserve d’inscription au plus tard 48 heures avant l’événement. En cas d’inscription, nous vous remercions de venir effectivement à la séance ou, en cas d’empêchement impromptu, de nous prévenir aussitôt que possible.
 François Dubuisson, Vaios Koutroulis, Olivier Corten et Anne Lagerwall, professeur·es de droit international à l’Université libre de Bruxelles (ULB), abordent dans cette vidéo différents aspects juridiques du conflit à Gaza, à travers 16 questions :
François Dubuisson, Vaios Koutroulis, Olivier Corten et Anne Lagerwall, professeur·es de droit international à l’Université libre de Bruxelles (ULB), abordent dans cette vidéo différents aspects juridiques du conflit à Gaza, à travers 16 questions :
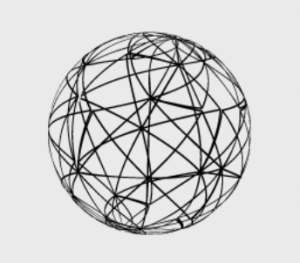 Ce 13 novembre 2023, le Conseil d’administration de la Société belge de droit international a adopté par consensus une déclaration sur le conflit à Gaza et le respect impératif, inconditionnel et immédiat du droit international dont vous pouvez consulter le texte en français ici et le texte en néerlandais ici. Vous trouverez par ailleurs toutes les informations à propos de la Société sur son site.
Ce 13 novembre 2023, le Conseil d’administration de la Société belge de droit international a adopté par consensus une déclaration sur le conflit à Gaza et le respect impératif, inconditionnel et immédiat du droit international dont vous pouvez consulter le texte en français ici et le texte en néerlandais ici. Vous trouverez par ailleurs toutes les informations à propos de la Société sur son site.
 Plusieurs membres du Centre de droit international se sont exprimés ces dernières semaines à propos des hostilités à Gaza.
Plusieurs membres du Centre de droit international se sont exprimés ces dernières semaines à propos des hostilités à Gaza.
François Dubuisson est intervenu dès le 7 octobre au Journal Télévisé de la RTBF deux jours plus tard dans l’émission spéciale Déclic de la RTBF. François Dubuisson s’est également exprimé dans les médias suivants : Télérama, France Culture, The Conversation, Le Soir, et La Libre. Sa dernière intervention date d’hier matin dans l’émission Cultures Monde sur Radio France. Anne Lagerwall était l’invitée de l’émission QR l’actu le 9 octobre et a pris part plus récemment à l’émission QR Débat de la RTBF. Vaios Koutroulis a été interviewé dans Déclic l’actu le 26 octobre. Olivier Corten quant à lui s’est exprimé dans Politis le 17 octobre dernier puis dans La Libre le 25 octobre. Enfin, Pierre Klein est intervenu dans La Croix le 18 octobre dernier et il était également l’invité de l’émission Les Visiteurs du Soir (émission du 9 novembre et émission du 10 novembre) sur LN24.

Le Centre de droit international vous invite à une table-ronde ce mardi 14 novembre, à 18h30.
Cette table-ronde, animée par Vaios Koutroulis (ULB), sera l’occasion d’écouter Olivier Corten (ULB), Anne Lagerwall (ULB) et Marco Longobardo (Université de Westminster et chercheur invité au Centre de droit international de l’ULB) sur le thème « Que dit le droit international sur les hostilités à Gaza? » – « What does international law have to say about the hostilities in Gaza? ».
INFOS PRATIQUES
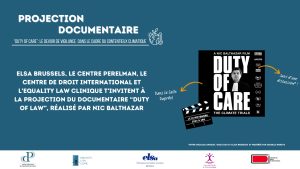

Le Centre de Droit International a le plaisir de vous convier au prochain Midi du Centre qui se tiendra le mardi 14 novembre 2023, à 12h15 et qui aura pour thème : « Interprétation uniforme des conventions multilatérales et intervention au procès : une vieille idée remise au goût du jour? ». La présentation sera assurée par Etienne HENRY, Référendaire à la Cour internationale de Justice et Chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel.
Pour rappel, les Midis du Centre de Droit International se déroulent dans la salle de réunion du Centre de Droit International (6, Av. Paul Héger, 1050 Bruxelles, Bâtiment H, 5ème étage, local H5.159). L’inscription est obligatoire via ce formulaire.
Des sandwiches seront offerts aux participant·es sous réserve d’inscription avant 12h00, au plus tard 48 heures avant l’événement. En cas d’inscription, nous vous remercions de venir effectivement à la séance ou, en cas d’empêchement impromptu, de nous prévenir aussitôt que possible.
 Le Centre de droit international a le plaisir de vous annoncer la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences juridiques de Monsieur Filip BATSELE , intitulée « The Start of a Regime: The First Generation of Western European Bilateral Investment Treaties (1959-1989) », en cotutelle avec l’Université de Gand et sous la co-direction des professeurs Dirk Heirbaut (UGent), Frederik Dhondt (VUB) et Nicolas Angelet (ULB).
Le Centre de droit international a le plaisir de vous annoncer la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences juridiques de Monsieur Filip BATSELE , intitulée « The Start of a Regime: The First Generation of Western European Bilateral Investment Treaties (1959-1989) », en cotutelle avec l’Université de Gand et sous la co-direction des professeurs Dirk Heirbaut (UGent), Frederik Dhondt (VUB) et Nicolas Angelet (ULB).
La défense prendra place le lundi 30 octobre 2023, à 18h00.
Plus de détails et infos pratiques : ICI