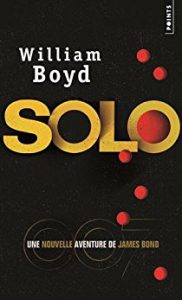 Comme cette réflexion que se fait Bond —James Bond— le suggère, le droit international occupe une place, mais une place toute relative, dans ses aventures. Il en est particulièrement ainsi de « Solo », que l’on doit à la plume de l’écrivain britannique William Boyd. Auteur de romans à succès et en même temps célébrés par la critique (comme on le constatera en visionnant l’extrait reproduit ci-dessous d’une émission « apostrophes » diffusée en 1985, Bernard Pivot s’était ainsi publiquement engagé à rembourser tout lecteur qui serait déçu par l’un de ses romans), Boyd est né à Accra et a publié plusieurs récits qui se déroulent en Afrique (Un Anglais sous les tropiques, 1981 ; Comme neige au soleil, 1982 ; Brazzaville plage, 1990, …) ainsi que, plus tardivement, un certain nombre de thrillers d’espionnage (La Vie aux aguets, 2006 ; Orages ordinaires, 2009 ; L’Attente de l’aube, 2012).
Comme cette réflexion que se fait Bond —James Bond— le suggère, le droit international occupe une place, mais une place toute relative, dans ses aventures. Il en est particulièrement ainsi de « Solo », que l’on doit à la plume de l’écrivain britannique William Boyd. Auteur de romans à succès et en même temps célébrés par la critique (comme on le constatera en visionnant l’extrait reproduit ci-dessous d’une émission « apostrophes » diffusée en 1985, Bernard Pivot s’était ainsi publiquement engagé à rembourser tout lecteur qui serait déçu par l’un de ses romans), Boyd est né à Accra et a publié plusieurs récits qui se déroulent en Afrique (Un Anglais sous les tropiques, 1981 ; Comme neige au soleil, 1982 ; Brazzaville plage, 1990, …) ainsi que, plus tardivement, un certain nombre de thrillers d’espionnage (La Vie aux aguets, 2006 ; Orages ordinaires, 2009 ; L’Attente de l’aube, 2012).
 Il n’est donc guère étonnant qu’il ait été choisi pour conter les aventures de James Bond, lesquelles se déroulent fort opportunément dans la République du Zanzarim, petit pays d’Afrique de l’Ouest lui-même devenu indépendant en 1964 (en succédant à l’Etat du Haut-Zanza, ancien territoire sous mandat issu d’une colonie allemande, le Neuzanza), puis déchiré par une guerre civile meurtrière en 1969. La « République démocratique du Dahum », soutenue diplomatiquement par la France, a en effet déclaré officiellement son indépendance, et les autorités zanzaries, qui ont les faveurs des autorités britanniques, tentent de juguler la tentative de sécession. Bond est chargé par sa hiérarchie de se rendre au Dahum en vue de faire de son dirigeant un « soldat moins efficace » (p. 51),
Il n’est donc guère étonnant qu’il ait été choisi pour conter les aventures de James Bond, lesquelles se déroulent fort opportunément dans la République du Zanzarim, petit pays d’Afrique de l’Ouest lui-même devenu indépendant en 1964 (en succédant à l’Etat du Haut-Zanza, ancien territoire sous mandat issu d’une colonie allemande, le Neuzanza), puis déchiré par une guerre civile meurtrière en 1969. La « République démocratique du Dahum », soutenue diplomatiquement par la France, a en effet déclaré officiellement son indépendance, et les autorités zanzaries, qui ont les faveurs des autorités britanniques, tentent de juguler la tentative de sécession. Bond est chargé par sa hiérarchie de se rendre au Dahum en vue de faire de son dirigeant un « soldat moins efficace » (p. 51), ce qui devrait permettre de « mettre fin à la guerre » (p. 48[1]*) au profit du gouvernement du Zanzarim. Sans surprise, et à la suite de multiples rebondissements, il y parvient, non sans en avoir profité pour assouvir non seulement sa soif (sa consommation de whisky, de brandy, de gin et de bière est particulièrement impressionnante, sous les tropiques ou ailleurs), mais aussi sa vengeance à l’encontre de certains de ses plus funestes et détestables ennemis, le tout en agissant à l’occasion en « solo », c’est-à-dire au-delà des instructions de son gouvernement (p. 205).
ce qui devrait permettre de « mettre fin à la guerre » (p. 48[1]*) au profit du gouvernement du Zanzarim. Sans surprise, et à la suite de multiples rebondissements, il y parvient, non sans en avoir profité pour assouvir non seulement sa soif (sa consommation de whisky, de brandy, de gin et de bière est particulièrement impressionnante, sous les tropiques ou ailleurs), mais aussi sa vengeance à l’encontre de certains de ses plus funestes et détestables ennemis, le tout en agissant à l’occasion en « solo », c’est-à-dire au-delà des instructions de son gouvernement (p. 205).
Une consécration d’une lecture réaliste des relations internationales ?
Comme cette très brève évocation du scénario le laisse entendre, le droit international ne semble pas au centre des préoccupations de l’agent 007. En ce sens, on semble retrouver ici une lecture réaliste des relations internationales assez caractéristiques du personnage (voyez, au sujet des adaptations cinématographiques, l’analyse de Jacobo Rios, « Jack Bauer, 007 et OSS 117 : quelles représentations du droit international ? » in O. Corten et F. Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma, Paris, Pedone, 2015, pp. 187-211). Particulièrement significatif est le regard que le lecteur est invité à dresser sur le dessous des cartes du conflit sécessionniste. Au-delà du facteur « ethnique » (la « République du Dahum » a été proclamée par les Fakassa, à l’encontre des Lowele, tribu dont les membres dirigent le Zanzarim) ou du « droit du Dahum à se séparer du Zanzarim » (comme le prétend un journaliste gauchiste envoyé sur place, p. 130), c’est le pétrole qui constitue le facteur qui dicte l’action des Etats, tout comme d’ailleurs celle des acteurs privés. En témoigne cette conversation entre Bond et « Felix », un homologue de la C.I.A. :
- [Felix] : « Nous sommes ici au cœur du delta du Zanza. Avec sous nos pieds un gigantesque océan de pétrole, intact, à peine exploité. On ignore à quel point ces réserves sont vastes. Ça pourrait dépasser le Ghawar d’Arabie Saoudite […]. Il ne s’agit pas d’un pétrole quelconque. C’est du ‘brut léger’. Le meilleur au monde, tellement plus facile à raffiner. Le monde le veut et le monde l’aura […] dans l’intérêt de tous ».
- [Bond] : « Tu parles de ‘l’intérêt de tous’, Felix, mais ce que tu veux dire c’est l’intérêt des pays occidentaux ».
- [Felix] : « Bien sûr. Imagine. Nous ne voulons pas dépendre du Golfe pour notre pétrole, dans la mesure du possible. C’est la poudrière proverbiale. Islam, Palestine, Israël, Chiites et Sunnites : le foutoir des foutoirs. Le Zanzarim, ai-je entendu dire, pourrait à lui seul fournir jusqu’à quarante pour cents de tous les besoins des Etats-Unis et de l’Angleterre réunis. Quarante pour cent et pas un chameau en vue ! Ça change tout » (pp. 326-327).
Dans ce contexte, on comprend que les acteurs de cette crise se laissent fréquemment aller à prendre quelque liberté avec le droit international. Le gouvernement britannique, par exemple, n’hésite pas à soutenir activement la partie gouvernementale, en lui fournissant armes (p. 65) et « instructeurs » (les guillemets sont dans le texte, pp. 95 et 199), et ce en dépit du principe de non-intervention dans les guerres civiles. Quant aux parties belligérantes zanzarie et danhumienne, elles agissent au mépris des règles du droit des conflits armés, en bombardant sans distinction (p. 126) ou en recrutant des mercenaires (p. 149), le tout sur fond d’« état de famine générale de la population civile » (p. 48) voire de « génocide au Dahum » (p. 56). A première vue, le droit international semble donc complètement ignoré. Mais à première vue seulement…
La pertinence de l’approche critique : la force (relative) du droit international
A l’analyse, il s’avère que le droit international n’est pas totalement absent comme cadre de références. On comprend au contraire en suivant les pérégrinations de l’agent Bond que le droit international peut tantôt inspirer l’esprit tantôt guider l’action des différents protagonistes du conflit. Illustrative est par exemple cette discussion, qui a lieu après que Bond ait assisté à une sordide mise en scène dans laquelle Kobus Breed, un mercenaire Rhodésien qui dirige les troupes dahumiennes, a pendu plusieurs cadavres de soldats sur des crochets de bouchers, le tout pour effrayer les troupes ennemies en approche.
« Bond, au bord de la nausée, se détourna des cadavres pendouillants et rejoignit Dimanche qui semblait tout autant affecté. ‘Fait-il ça tout le temps ? lui demanda-t-il.
- Oui. Il aime ça trop. Beaucoup trop.
- Moi ça ne me plaît pas, dit Bond. C’est révoltant.
- Suis d’accord avec vous, sar, approuva Dimanche. Ils sont juste des soldats comme nos hommes à nous » (nous soulignons, pp. 146-147).
Ainsi, Dimanche, le jeune dahumien au service de Bond, rationalise la répulsion de ce dernier devant une atrocité, incompatible avec le respect de tout combattant en droit international humanitaire, reconnu de manière égale et réciproque à tous les participants au conflit. La première Convention de Genève de 1949 prévoit ainsi que « [l]es restes des personnes qui sont décédées … doivent être respectées … », une règle manifestement considérée comme coutumière. Plus généralement, et au-delà de leur présence dans les consciences, certaines règles semblent bel et bien exercer une certaine influence, sur le terrain. Ainsi, on apprend que la France a « plus ou moins reconnu de facto l’Etat dahumien » (p. 53), ce qui signifie qu’elle ne l’a pas reconnu officiellement, refusant de donner suite aux demandes répétées de ses autorités (« si le gouvernement français pouvait reconnaître le Dahum, tout changerait », p. 132) et par là même de mettre en cause le principe de non-intervention. C’est aussi en application de ce même principe que le Royaume-Uni a refusé de reconnaître l’entité sécessionniste (p. 80). Par ailleurs, si Londres a soutenu la partie gouvernementale, c’est manifestement de manière limitée et officieuse, ce qui semble témoigner paradoxalement d’une certaine révérence en faveur de la règle de non-immixtion dans les guerres civiles. D’ailleurs, et au bout du compte, la sécession échoue et les frontières internationales existantes sont stabilisées, ce qui pourrait être interprété comme une consécration de la règle de l’uti possidetis juris, selon laquelle les anciennes frontières coloniales doivent être maintenues après l’accession des anciennes colonies à l’indépendance, la stabilité —ou l’intangibilité des frontières, comme on le dit parfois— étant un objectif qui devrait prévaloir sur tout autre considération, qu’elle soit historique, « naturelle » ou « ethnique ». C’est ce que regrette un général dahumien, lorsqu’il affirme :
« Le Zanzarim, et avant cela l’Etat du Haut-Zanza, et avant encore le Neuzanza, a été une invention des colonialistes européens. Qui sont arrivés il y a quelques décennies, à la fin du siècle dernier. Ils ont tracé les frontières du pays par un bel après-midi, sur un caprice, alors qu’ils n’avaient rien de mieux à faire […]. Pour les Fakassa, le delta du fleuve Zanza, notre fief tribal, nous appartient de naissance. Il n’a rien à voir avec la politique néocoloniale du vingtième siècle ou les ambitions vénales d’aventuriers européens. Pouvez-vous comprendre cela ? » (pp. 59-60).
Enfin, remarquons que même si Bond décide soudainement d’agir en « solo », et donc ultra vires, l’Etat britannique endosse finalement toute la responsabilité pour ses actions : « nous sommes des serviteurs du gouvernement de Sa Majesté, quelle que soit sa couleur politique. Nous faisons partie des services secrets. Des fonctionnaires au sens pur du terme » (p. 335). On retrouve ici écho la règle énoncée à l’article 7 du projet de la commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat
« Le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions ».
Alors, oui, aux termes de la découverte de cette nouvelle aventure de l’agent 007, la lectrice ou le lecteur ne peuvent que le constater : « il y avait là en jeu plus que le désir de préserver les règles du droit international » (p. 80). Mais, comme dans la réalité (les événements sont manifestement inspirés de la tentative de sécession du Biafra réprimée par le Nigéria de 1967 à 1970, avec l’aide des autorités britanniques), ces règles jouent en même temps un certain rôle.

Elles peuvent effectivement inspirer ou motiver les acteurs, ou encore limiter leur marge de manœuvre. De ce point de vue, l’école dite « réaliste » des relations internationales ne l’est pas toujours tant que ça, et on serait plus tenté de se tourner vers l’approche « critique », qui prescrit de mettre la règle de droit en relation avec les rapports de force qui en déterminent la création comme l’interprétation ou l’application (Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, AUF, 2001, pp. 290-291). Ainsi, si rien ne garantit qu’une règle soit respectée, rien n’exclut qu’elle ne le soit, même si ce respect résulte non d’une mystérieuse et indéfinissable force normative mais d’un contexte politique particulier qui, en définitive, renvoie à la volonté et à la pression exercée par les acteurs de la société internationale.
-
* Les pages indiquées sont celles de la version parue en français aux éditions du Seuil, en 2014. ↑
