 Ainsi l’« affaire Arendt » – plutôt que l’« affaire Eichmann » – a-t-elle été portée à l’écran. L’un des événements cinématographiques marquants de l’année 2013 est en effet la sortie d’un film allemand, réalisé par Margarethe von Trotta, consacré à la vie de Hannah Arendt afin d’illustrer certaines dimensions de sa pensée. On savait depuis longtemps que la vie de la philosophe avait quelque chose de fascinant (et ce bien au-delà de la couverture du procès Eichmann et de ses suites ; pensons à sa liaison avec Martin Heidegger). Un élément cinématographique peut à présent être ajouté au dossier.
Ainsi l’« affaire Arendt » – plutôt que l’« affaire Eichmann » – a-t-elle été portée à l’écran. L’un des événements cinématographiques marquants de l’année 2013 est en effet la sortie d’un film allemand, réalisé par Margarethe von Trotta, consacré à la vie de Hannah Arendt afin d’illustrer certaines dimensions de sa pensée. On savait depuis longtemps que la vie de la philosophe avait quelque chose de fascinant (et ce bien au-delà de la couverture du procès Eichmann et de ses suites ; pensons à sa liaison avec Martin Heidegger). Un élément cinématographique peut à présent être ajouté au dossier.
Les points de focalisation de la polémique suscitée par la publication, en 1963, d’Eichmann à Jérusalem peuvent être brièvement rappelés : premièrement, il était reproché à Arendt d’avoir mis en cause le rôle des « conseils juifs », c’est-à-dire des organes représentatifs juifs, durant les années d’extermination ; ensuite, sa façon d’aborder la personnalité d’Eichmann et sa « thèse » corrélative de la banalité du mal avaient été soumises à la critique.

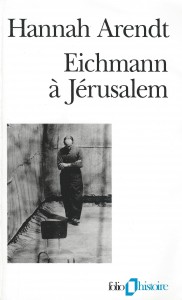 Une conséquence moins souvent aperçue de l’immense et violente controverse qui s’est déployée des deux côtés de l’Atlantique, et même au-delà, est qu’elle a conduit à masquer une dimension centrale de la réflexion d’Arendt : la justice. Eichmann à Jérusalem nous parle en effet de justice et, malgré certaines ambiguïtés, il s’agit d’un livre qui traite non de l’impossibilité de la justice humaine, mais de sa possibilité même, et ce alors que nous nous trouvons confrontés à des faits et à des crimes aussi extrêmes que révoltants, aussi inédits que déconcertants.
Une conséquence moins souvent aperçue de l’immense et violente controverse qui s’est déployée des deux côtés de l’Atlantique, et même au-delà, est qu’elle a conduit à masquer une dimension centrale de la réflexion d’Arendt : la justice. Eichmann à Jérusalem nous parle en effet de justice et, malgré certaines ambiguïtés, il s’agit d’un livre qui traite non de l’impossibilité de la justice humaine, mais de sa possibilité même, et ce alors que nous nous trouvons confrontés à des faits et à des crimes aussi extrêmes que révoltants, aussi inédits que déconcertants.
 Le long métrage de Margarethe von Trotta a le mérite de mettre cette dimension de la pensée d’Arendt à l’avant-plan. Le procès Eichmann ne sert en effet pas uniquement de toile de fond à l’intrigue ; il en est également rendu compte, de façon intelligente, au moyen d’images d’archives. Le mariage entre images de fiction et image d’archives se retrouve dans le premier extrait que j’ai sélectionné, lequel met en outre en évidence un élément important du procès dont je vais immédiatement proposer un commentaire.
Le long métrage de Margarethe von Trotta a le mérite de mettre cette dimension de la pensée d’Arendt à l’avant-plan. Le procès Eichmann ne sert en effet pas uniquement de toile de fond à l’intrigue ; il en est également rendu compte, de façon intelligente, au moyen d’images d’archives. Le mariage entre images de fiction et image d’archives se retrouve dans le premier extrait que j’ai sélectionné, lequel met en outre en évidence un élément important du procès dont je vais immédiatement proposer un commentaire.
Dans cet extrait, la réalisatrice insiste ainsi sur l’opposition d’Arendt à la vision ainsi qu’au « style » qui sont ceux de Gideon Hausner, procureur chargé de l’accusation lors du procès d’Adolf Eichmann devant le tribunal de Jérusalem. Le discours d’ouverture du procureur était certes destiné à émouvoir, et il a ému de nombreux observateurs ; Arendt n’y voit, quant à elle, que « rhétorique de pacotille » (Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, ci-après « EJ », p. 1037). De manière plus générale, elle reproche au procureur, outre ses effets de manches, d’une part, de se focaliser sur les souffrances des Juifs et non sur les actes d’Eichmann et, d’autre part, de substituer à l’objectif authentique du procès, qui consiste à juger un homme, un objectif plus général : insérer la Shoah et la création de l’État d’Israël dans l’histoire millénaire de l’antisémitisme. Or, selon Arendt, et elle est inflexible sur ce point, le but d’un procès, aussi exceptionnel soit-il, n’est pas de faire de la politique ou de réécrire l’histoire, mais de rendre le droit. La tâche qui incombait au tribunal de Jérusalem était donc la suivante : peser les charges retenues contre l’accusé, écouter les arguments de l’accusation et de la défense, ainsi que les témoins, évaluer les documents produits par les parties, mener les débats et, finalement, rendre un verdict, verdict qui concerne une personne « en chair et en os » et non un système politique, une idée abstraite ou une tendance historique. Cela, nous dit Arendt, les juges de Jérusalem, au contraire du procureur et du Premier ministre israélien David Ben Gourion, l’ont très bien compris. À la mise en scène « politique » du procès,  répond la retenue des juges qui ont constamment tenté de s’opposer à l’instrumentalisation du procès de Jérusalem, qui se sont efforcés d’empêcher que « le procès ne devienne un procès-spectacle, sous l’influence du procureur et de son goût pour la mise en scène » (EJ, 1022). Tandis que le procureur sert l’État d’Israël, les juges servent la justice. L’opposition que trace Arendt entre l’État et la justice est flagrante, presque caricaturale.
répond la retenue des juges qui ont constamment tenté de s’opposer à l’instrumentalisation du procès de Jérusalem, qui se sont efforcés d’empêcher que « le procès ne devienne un procès-spectacle, sous l’influence du procureur et de son goût pour la mise en scène » (EJ, 1022). Tandis que le procureur sert l’État d’Israël, les juges servent la justice. L’opposition que trace Arendt entre l’État et la justice est flagrante, presque caricaturale.
Arendt ne s’est toutefois pas contentée de développer, à partir du « cas Eichmann », une réflexion générale sur la justice, et même un éloge de celle-ci : elle s’est aussi penchée sur certaines particularités plus techniques de cette affaire. Un autre extrait rend compte de cet intérêt arendtien pour les questions juridiques soulevées par l’affaire Eichmann. La scène se déroule dans l’appartement new-yorkais de Hannah Arendt et de son mari Heinrich Blücher. Différents convives, parmi lesquels figure le célèbre philosophe Hans Jonas, sont alors réunis afin de fêter le départ d’Arendt pour Jérusalem et la couverture du procès Eichmann qu’elle s’apprête à réaliser.
Il est possible de mettre en évidence, à partir de cet extrait, deux thèses antagoniques, l’une incarnée par Heinrich Blücher, l’autre par Hans Jonas. Suivant Blücher, le procès d’Adolf Eichmann serait illégal, cette illégalité procédant du rapt commis en Argentine par le Mossad, c’est-à-dire par les services secrets israéliens. Hans Jonas, qui représente l’autre thèse, justifie quant à lui la compétence des autorités israéliennes en invoquant le « droit sacré d’Israël » de juger un nazi pour les crimes qu’il a commis contre le peuple juif. C’est finalement la vieille querelle entre, d’une part, une posture positiviste et formaliste et, d’autre part, une position jusnaturaliste qui est ici mise en scène.
Alors que Blücher conteste vigoureusement l’argument avancé par Jonas (en invoquant la « folie » de ce dernier, stratégie rhétorique vieille comme le monde…), Arendt semble se ranger du côté de celui-ci plutôt que du côté de son mari. Elle s’appuie cependant sur des arguments plus « factuels » : elle rappelle qu’une forte proportion des survivants de la Shoah a trouvé refuge en Israël ; elle insiste en outre sur la continuité entre les procès de Nuremberg et le procès alors sur le point de se tenir en Israël : puisqu’Eichmann devait se présenter devant le tribunal de Nuremberg, mais qu’il était à l’époque en fuite, puisqu’aucune juridiction ne semble en mesure de reprendre l’affaire, puisque l’Allemagne ne réclame pas son extradition, Israël est en droit de le juger (lettre du 23 décembre 1960 de Hannah Arendt à Karl Jaspers, EJ, pp. 1319 à 1323). L’une des questions juridiques qui est ici présente, en filigrane, est celle de l’enlèvement d’Eichmann et, plus précisément encore, la question des conséquences éventuelles d’un tel acte illégal sur la validité du procès de Jérusalem.
Dans Eichmann à Jérusalem, Arendt rappelle cet argument invoqué de manière assez prévisible par l’avocat d’Eichmann lors du procès : puisque l’accusé avait été « amené en Israël en violation du droit international », le droit que détenait l’État d’Israël de l’inculper avait, été, dès le départ, vicié. Il s’agit ici d’une application du principe de droit international que résume l’adage ex injuria jus non oritur (auquel répond, comme on le sait, un principe opposé : ex factis jus oritur). Arendt rappelle le raisonnement avancé par les autorités israéliennes pour contrer une telle exception d’illégalité : « la violation du droit international ne concernait que les États d’Israël et d’Argentine et non les droits de l’accusé » ; en outre, « cette violation avait été ‘réparée’ le 3 août 1960 par la déclaration conjointe des deux gouvernements, aux termes de laquelle ils avaient ‘résolu de considérer comme clos l’incident provoqué dans le sillage de l’action de citoyens d’Israël ayant porté atteinte aux droits fondamentaux de l’État d’Argentine’ » (EJ, 1250).
De l’avis d’Arendt, la circonstance suivant laquelle Eichmann avait été amené en Israël en violation du droit international constituait un trait caractéristique du procès de Jérusalem, qui le distinguait des autres procès successeurs aux procès de Nuremberg. On avait ici affaire à une violation du « principe territorial dont la signification principale réside dans le fait que la terre est habitée par de nombreux peuples et que ces peuples sont régis par des lois très différentes, de sorte que toute extension de la loi d’un territoire au-delà des frontières et des limitations de sa validité mettra immédiatement cette loi en conflit avec celle d’un autre territoire » (EJ, 1273). Toutes les justifications que l’on pouvait apporter à une telle violation du droit international, bien que très légitimes, n’étaient en quelque sorte que des justifications « faibles », car liées à des circonstances particulières, à une conjoncture historico-politique déterminée, comme « le caractère sans précédent du crime » de génocide, « la naissance d’un État juif » ou des arguments de pure realpolitik (« dès lors qu’on était décidé à faire comparaître Eichmann en justice », la question qui se posait était la suivante : comment le faire sortir d’un pays – l’Argentine – qui battait à l’époque « tous les records de non-extradition de criminels nazis » (EJ, 1273)).
 Dans la même veine, Arendt insiste sur une particularité de la situation de l’accusé : celui-ci conservait techniquement la nationalité allemande, dont il n’avait jamais été déchu, mais, n’étant pas réclamé par la nouvelle République fédérale d’Allemagne, il était, sur le plan factuel, une sorte d’« apatride ». La philosophe estime cette circonstance tout à fait déterminante : « en dépit des pages entières d’arguments juridiques fondés sur des précédents si nombreux qu’on finit par croire que l’enlèvement est un des modes d’arrestation les plus courants, c’est le fait qu’Eichmann soit de facto apatride et rien d’autre qui permit au tribunal de Jérusalem de le juger » (EJ, 1250). Ici comme souvent, la réflexion d’Arendt se situe à la frontière des domaines du droit et de la politique, et elle n’est d’ailleurs pas dénuée d’une pointe d’ironie…
Dans la même veine, Arendt insiste sur une particularité de la situation de l’accusé : celui-ci conservait techniquement la nationalité allemande, dont il n’avait jamais été déchu, mais, n’étant pas réclamé par la nouvelle République fédérale d’Allemagne, il était, sur le plan factuel, une sorte d’« apatride ». La philosophe estime cette circonstance tout à fait déterminante : « en dépit des pages entières d’arguments juridiques fondés sur des précédents si nombreux qu’on finit par croire que l’enlèvement est un des modes d’arrestation les plus courants, c’est le fait qu’Eichmann soit de facto apatride et rien d’autre qui permit au tribunal de Jérusalem de le juger » (EJ, 1250). Ici comme souvent, la réflexion d’Arendt se situe à la frontière des domaines du droit et de la politique, et elle n’est d’ailleurs pas dénuée d’une pointe d’ironie…
Ce qui est frappant dans la discussion qu’Arendt consacre à cette question, celle de l’enlèvement d’Eichmann et de ses conséquences, c’est la critique radicale, et sans doute excessive, qu’elle oppose à la volonté (à mon sens bien légitime) des juges israéliens de justifier leurs décisions en se fondant sur des précédents. Selon elle, le cas Eichmann était précisément « sans précédent », principalement parce que l’accusé n’était pas traduit devant les tribunaux du pays dans lequel les faits avaient été initialement commis. Symptôme remarquable de cet agacement d’Arendt à l’égard du geste, typiquement juridique selon elle, de se référer à des précédents, elle dit de la jurisprudence, au détour d’un paragraphe, qu’elle est « obsédée par la logique » (EJ, 1302). Il s’agit là d’un des nombreux « mouvements d’humeur » qui habitent Eichmann à Jérusalem, texte complexe, texte polémique, texte aux multiples facettes. La « logique » à laquelle obéit la jurisprudence me paraît plus subtile que ce qu’a décidé d’en retenir ici Arendt, plus créative, plus « analogique » que strictement « logique ».
De telles limitations du texte arendtien ne devraient pas, à mon sens, nous conduire à mettre de côté un livre comme Eichmann à Jérusalem, qui, malgré certaines maladresses, interroge de façon extrêmement puissante et stimulante nos conceptions courantes de la justice et qui réhabilite la dimension politique éminente du jugement humain. Concernant plus particulièrement la justice pénale internationale, le recours à l’œuvre d’Arendt est selon moi d’une grande utilité dès lors qu’il s’agit de percevoir les grands principes sur lesquels repose une telle institution. Peut-être Arendt est-elle moins éclairante lorsqu’elle tente de se positionner à l’égard de problèmes plus techniques, dont elle ne perçoit sans doute pas toutes les subtilités.
Comme je l’ai indiqué plus haut, le film de Margarethe von Trotta a le mérite de souligner cette rencontre en quelque sorte fortuite, qui prit place dans un contexte particulier – celui du procès de Jérusalem –, entre Arendt et le problème de la justice. Sur ce plan, il constitue selon moi une indéniable réussite. Sans doute parce que la réalisatrice a bien perçu l’un des traits centraux de la démarche intellectuelle de Hannah Arendt : penser non seulement librement, « sans garde-fou » comme elle le disait parfois, mais aussi penser à partir d’événements, en s’y nourrissant, en y revenant sans cesse. En usant de l’un de ces aphorismes métaphoriques qu’elle affectionnait tant, la philosophe a un jour parfaitement résumé cette caractéristique essentielle de sa méthode : « La courbe que décrit l’activité de pensée doit rester liée à l’événement comme le cercle reste lié à son foyer ». On peut dire du film de Margarethe von Trotta qu’il parvient à décrire l’un de ces « cercles de pensées » qu’Arendt s’est attachée sa vie durant à dessiner au milieu des vicissitudes du XXe siècle.
Vincent Lefebve
Assistant au Centre de droit international et au Centre de droit public de l’ULB
