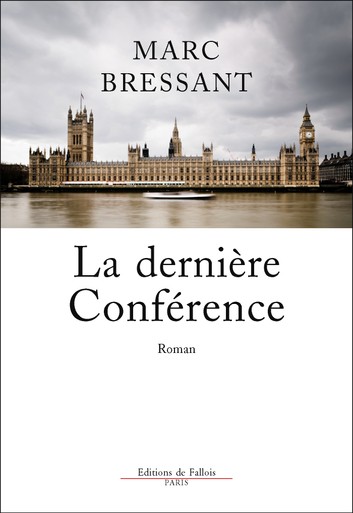 Roman publié en 2008 aux éditions de Fallois, La dernière Conférence obtint la même année le Grand Prix du Roman de l’Académie française. Son auteur, Marc Bressant (né Patrick Imhaus, en 1938), est à la fois romancier, diplomate et homme de télévision. Il n’est pas rare que des hommes de plume aient épousé la Carrière, et vice versa (Chateaubriand, Joseph de Maistre, Paul Claudel, Albert Cohen, Romain Gary, Jean-Christophe Ruffin, pour n’en citer que quelques-uns dans la littérature francophone). Il est dès lors toujours très réjouissant d’observer comment les subtilités diplomatiques peuvent être transposées au fil des pages. Précisément, à quoi tiendrait donc cet aspect « réjouissant », tant on sait que, s’agissant de la diplomatie en général, et des organisations internationales en particulier, les montagnes accouchent la plupart du temps de souris. On ne peut qu’afficher un sourire narquois à la description qu’en faisait déjà, dans un Bulletin du CICR d’avril 1986, Alain Modoux (un ancien haut fonctionnaire international) :
Roman publié en 2008 aux éditions de Fallois, La dernière Conférence obtint la même année le Grand Prix du Roman de l’Académie française. Son auteur, Marc Bressant (né Patrick Imhaus, en 1938), est à la fois romancier, diplomate et homme de télévision. Il n’est pas rare que des hommes de plume aient épousé la Carrière, et vice versa (Chateaubriand, Joseph de Maistre, Paul Claudel, Albert Cohen, Romain Gary, Jean-Christophe Ruffin, pour n’en citer que quelques-uns dans la littérature francophone). Il est dès lors toujours très réjouissant d’observer comment les subtilités diplomatiques peuvent être transposées au fil des pages. Précisément, à quoi tiendrait donc cet aspect « réjouissant », tant on sait que, s’agissant de la diplomatie en général, et des organisations internationales en particulier, les montagnes accouchent la plupart du temps de souris. On ne peut qu’afficher un sourire narquois à la description qu’en faisait déjà, dans un Bulletin du CICR d’avril 1986, Alain Modoux (un ancien haut fonctionnaire international) :
« Pour l’observateur extérieur, les conférences internationales se suivent et se ressemblent : les résultats visibles et tangibles sont rares, les mots disent tout, voire trop, mais ils ne résolvent pas grand-chose. Les arènes du verbe que sont devenues les conférences sont de plus en plus perçues, par le public, comme le lieu privilégié d’affrontements oratoires stériles, où les belles promesses restent sans lendemain ».
A cet égard, La dernière Conférence illustre à merveille comment les caucus internationaux, s’ils ambitionnent initialement de produire des textes faisant date, sont souvent davantage des microcosmes où l’on cocktaile, séduit et déambule, en professant de grandes idées tout en vaquant à ses petites ambitions. L’ouvrage révèle, parfois avec légèreté, parfois sur un ton plus désabusé, qu’in fine, les déclarations et autres actes institutionnels deviennent solubles dans les coupes de champagne, et que les fioritures diplomatiques finissent par prendre le pas sur les ordres du jour politiques et juridiques. En fait, au fil des pages, on en vient à se demander quelles sont les avancées concrètes qui peuvent découler d’un tel barnum international.
Avant de répondre à cette question, commençons par poser le cadre historique et juridique de ladite « dernière conférence » (1), afin d’évaluer au mieux la crédibilité du décor installé par l’auteur (2).
(1). « Pavane pour une bipolarité défunte » : le cadre historique et juridique du récit
Le récit a pour cadre ce qui est censé être la dernière conférence placée sous les auspices de la C.S.C.E. (Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe), que Bressant situe entre octobre et décembre 1989. Officiellement, cette assemblée (fictive) porte sur la circulation de l’information. La narration est prétexte à l’exposé des grands événements qui annoncent symboliquement la fin de la Guerre froide en Europe : la chute du Mur de Berlin et l’effondrement des régimes socialistes dans les pays d’Europe centrale et orientale (« un tremblement de terre d’une magnitude inouïe s’était produit sur notre continent » avec la déglingue à l’Est, « les leaders indéboulonnables, les symboles et les dogmes, les frontières et les murs [tombant], comme dans un gigantesque jeu de dominos » ; cf. M. BRESSANT [ci-après « MB »], La dernière Conférence, Paris, de Fallois, 2008, p. 176). Ne manque au tableau que la dissolution de jure de l’U.R.S.S. (le 26 décembre 1991), qui marque officiellement la fin à la fois de la Guerre froide et de la bipolarité. Dès lors, d’un point de vue technico-historique, parler de « dernière conférence » de la Guerre froide apparaît comme une erreur factuelle, puisqu’elle celle-ci n’achèvera sa course qu’avec la démission de Gorbatchev (25 décembre 1991), et la disparition juridique de l’Union Soviétique (le lendemain). Mais c’était là une accroche tentante pour le titre du roman…
Indépendamment du fait que cette Conférence de Londres sur l’Information n’a jamais eu lieu [1], on notera toutefois qu’un Forum de l’Information a pris place, à Londres, entre le 18 avril et le 12 mai de la même année, mais sans que les pays du Pacte de Varsovie n’y tiennent caucus. L’objet de ce Forum [2] était de discuter de l’amélioration de la circulation, de l’accès et de l’échange de l’information, ainsi que de l’amélioration des conditions de travail des journalistes (voy. E. REMACLE, « La CSCE. Mutations et perspectives d’une institution paneuropéenne », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1992/3, n°1348-49, p. 24). Terminé sans qu’un document final concluant ne voie le jour, ce Forum exerça toutefois, dans l’esprit, une certaine influence, puisqu’un grand nombre des propositions qui y avaient été formulées furent ensuite abordées dans d’autres groupes de travail intra-C.S.C.E. Cependant, les résultats du Forum de Londres devinrent bien vite obsolètes, du fait des développements politiques en Europe centrale et orientale.
Contrairement à ce que semble exposer Bressant, la C.S.C.E. n’était pas une organisation internationale [3], mais plutôt un rassemblement d’Etats librement organisé (voy. M. SAPIRO, « Changing the CSCE into the OSCE: Legal Aspects of a Political Transformation », A.J.I.L., 1995, Vol. 89, N°3, p. 631). Comme toute conférence internationale, c’était « une réunion d’individus appelés par le biais de la discussion à accomplir une tâche limitée en un laps de temps mesuré » (d’après la définition de Margaret Mead citée chez C. CALI, « Les échanges rituels dans les conférences internationales », Les Carnets du Cediscor, 2001 [mis en ligne en mai 2009], §1er, http://cediscor.revues.org/311 [dernièrement consulté le 15 avril 2020]), une « institution type de la société œcuménique du droit des gens » (G. SCELLE, « L’évolution des conférences internationales », Bulletin international des sciences sociales, 1953, Vol. V, n°2, p. 257). Elle n’était pas pourvue de tous les organes que l’on s’attend à trouver dans une telle structure institutionnelle (par exemple, elle n’avait pas de Secrétariat général permanent – contrairement à ce que l’ouvrage rapporte [MB, p. 16] – mais plutôt un secrétariat exécutif mis à disposition par le pays-hôte de la conférence ou de la réunion, et qui était en charge d’un support administratif minimal). La C.S.C.E. (à la différence de l’O.S.C.E., qui lui succédera en 1994) consistait plutôt en des Réunions sur les Suites (Follow-Up Meetings) organisées tous les deux ou trois ans [4], en fonction de la volonté des Etats participant, et qui prenaient place dans la capitale d’un des Etats membres de la Conférence [5]. En plus de ces Réunions sur les Suites, des meetings d’experts ad hoc se tinrent régulièrement à partir de 1978, sur des thématiques spécifiquement circonscrites, comme ce fut précisément le cas du Forum de Londres sur l’Information. En transformant la C.S.C.E. en O.S.C.E. – soit en passant d’un ensemble de conférences interétatiques espacées à une organisation permanente et institutionnalisée – les Etats Membres montraient par-là leurs attentes dans le fait que la seconde jouerait un rôle plus efficient dans la prévention des conflits régionaux, la gestion des crises et la résolution des différends (H. EYRAUD, La Fin de la Guerre froide. Perspectives, Lyon, PUL, 1992, pp. 106-108 ; A. PLANTEY, La négociation internationale. Principes et méthodes, Paris, CNRS Éditions, 1994, p. 245, n°1004).
Politiquement, la C.S.C.E. était une création typique de la Guerre froide ; c’était même au départ sa raison sociale, en quelque sorte. Comme l’auteur le fait dire à son personnage principal, l’ambassadeur Tromelin : « Et nous alors, […] dans notre Conférence estampillée ‘guerre froide’, qu’est-ce que nous allons devenir si l’on nous ôte notre raison sociale ? » (MB, p. 165 ; souligné par nous et par l’auteur). La Conférence garantissait au Vieux Continent déchiré par le Rideau de fer un dialogue paneuropéen. Elle a même (selon le joli mot de Serge Sur) « accompagné la chute pacifique de l’U.R.S.S., l’a en quelque sorte aidée à mourir » (S. SUR, Relations internationales, 3ème éd., Paris, Montchrestien, 2004, p. 137). Si, à ses débuts, la Conférence apparut comme une puissante dynamique étrangère aux blocs, elle finit par s’essouffler en cours de route, ressemblant à « une embarcation percée de partout » (MB, p. 86), qui semblait n’accoucher bien souvent que de souris (ibid.). Le jugement peut sembler sévère : quand on connaît l’antinomie profonde des intérêts et les antagonismes des deux blocs, on ne peut que saluer l’œuvre de la C.S.C.E., qui « a introduit une dynamique nouvelle de la détente, [en faisant] référence aux hommes et aux peuples ; […] [dont l’acte fondateur] contient nombre de dispositions très concrètes touchant la libre circulation des personnes, des idées et des informations, visites de familles, réunions des familles séparées, mariages mixtes, conditions de travail des journalistes étrangers, accès du public à la presse étrangère… La C.S.C.E. est l’illustration la plus parfaite de l’esprit de compromis qui a dominé l’âge d’or de la détente » (J. HUNTZINGER, « Les relations Est-Ouest », Encyclopædia Universalis, tomes 8, Paris, 1993, p. 835 ; nous soulignons).
En droit, cependant, la C.S.C.E. a sans doute souffert de son manque d’institutionnalisation. Fondée par l’Acte final d’Helsinki (1975) qui n’était pas juridiquement contraignant, les différentes déclarations dont elle a accouché ne furent que de principe. Formellement parlant, la C.S.C.E. n’a jamais été autre chose qu’une succession de conférences diplomatiques occasionnelles. Les représentants des Etats Membres qui y participaient, par une sorte de « dédoublement fonctionnel », étaient censés tout à la fois exprimer les vues de leur gouvernement et définir une position commune. Toutefois, le défaut essentiel d’une telle approche était que les participants aux négociations s’employaient à faire prévaloir les intérêts nationaux tels qu’ils se reflètent dans les instructions de leur gouvernement, la décision finale ne se réduisant dès lors plus qu’au « plus petit commun multiple » de ces volontés gouvernementales (voy. P. DAILLIER, M. FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, 8ème éd., 2009, n°402). Pour citer l’ambassadeur Tromelin :
« Nous voici donc séquestrés ici tous ensemble […], fin prêts à nous étriper pour quelques poignées de virgules. […] Car la discussion qui [nous] a occupé[s] […] avait de quoi laisser songeur. Nous était soumis l’avant-projet des cinq premiers articles de la Déclaration. Le texte était le produit d’une bonne dizaine de réunions d’experts tenues aux quatre coins de l’Europe. Supposé définir les termes employés dans les soixante-treize articles qui suivent, ce n’était qu’une suite de truismes et de non-dits. Normal puisque des mots essentiels comme liberté, garantie ou opinion publique ont des sens rigoureusement opposés pour chacun des deux camps. » (MB, p. 40 ; souligné par lui).
(2). « Cris et chuchotements » : une analyse de la trame narrative du roman
Cette brève description du décor plantée, quels sont les messages qui semblent contenus dans la trame narrative ?
Premièrement, en sélectionnant un passage révélateur de l’ouvrage, c’est bien à une fonction d’avertissement que l’on pense :
« […] cette paix étrange qu’on avait baptisée l’équilibre de la terreur. […] Et, hélas, depuis la Chute, celle du Mur s’entend, nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes ! Selon les renseignements [britanniques], ce n’est, du reste, que le tout début d’une offensive tous azimuts contre l’idéologie occidentale. Et contre l’Occident. ‘Tu verras, on finira par la regretter, notre bonne vieille guerre froide !’ » (MB, pp. 180 et 183-184 ; souligné par l’auteur)
Dans cet extrait, le narrateur – et l’auteur – semble(nt) nous mettre en garde : ce monde bipolaire, avec ses blocs antinomiques se faisant face, qui s’affrontaient dans des guerres lointaines par le biais d’intermédiaires, cette époque de dissuasion nucléaire et de lutte idéologique – quoique de plus en plus feutrée au fil des décennies – n’avaient-ils pas plus d’avantages que l’ère qui s’ouvrit au début des années 1990, décelant la boîte de Pandore des idéologies radicales, du terrorisme et de l’instabilité ? Le « monde » (ou, pour l’écrire plus prosaïquement, plus égotistement, l’Occident) a-t-il vraiment gagné à troquer un adversaire identifié, confiné à des portions de territoires et retenu par des barrières (fussent-elles symboliques), pour de nouveaux ennemis, bien plus redoutables car plus insaisissables, polymorphes et – à maints égards – déterminés (voy. par ex. B. DENIS, « Paix et politique internationale : fragments de quelques tendances et enjeux actuels », in P. CALAME, B. DENIS et E. REMACLE [dir.], L’Art de la Paix. Approche transdisciplinaire, Bruxelles, P.I.E./Peter Lang, 2004, pp. 261-263 et 266-268) ?
C’est en réalité la théorie dite « des turbulences » de James Rosenau – typique de la fin de la Guerre froide – qui ressort ainsi en filigrane au fil des pages du roman. Selon cette théorie (J.N. ROSENAU, Turbulence in World Politics. A theory of Change and Continuity, Princeton, PUP, 1990), la multiplication des acteurs agissant en dehors du cadre de la souveraineté (les groupes terroristes ou religieux, les mafias) et la dispersion des identités (qui ne peuvent plus s’incarner dans une allégeance unique envers l’Etat), seraient à l’origine de ces turbulences. Dès lors, la tentation fut grande chez certains, assistant au déclin du rôle de l’Etat sur la scène internationale – lui-même confronté à des compétiteurs non-étatiques –, d’y ajouter l’affaiblissement des diplomates, représentants par excellence de l’Etat. Aussi, d’autres ont en réaction réaffirmé plus que jamais la nécessité des diplomates dans un monde en plein chaos :
« La fin de la bipolarité, le nouveau désordre mondial ne rendent que plus nécessaire l’intervention des Etats et en particulier celle des diplomates », note Samy Cohen. « Il devient plus important encore que par le passé de savoir comprendre et interpréter les changements internationaux, imaginer des solutions aux problèmes mondiaux, communiquer. […] Alors que la Guerre Froide ne leur accordait qu’un espace de réflexion limité, un contexte international turbulent devient presque une aubaine pour les diplomates. » (S. COHEN, « L’art de gérer les turbulences mondiales », in S. COHEN [dir.], Les diplomates. Négocier dans un monde chaotique, Paris, Autrement, 2002, pp. 14-15)
*
Un deuxième passage méritant un commentaire est celui-ci :
« […] notre Conférence n’est qu’un spectacle à l’intérieur de la superbe pièce que l’Europe se joue en ce moment à elle-même. Du théâtre dans le théâtre, un truc vieux comme le monde. Et, une fois de plus, le procédé se révélait d’une grande efficacité scénique » (MB, p. 160 ; nous soulignons).
L’extrait a tout d’une mise en abyme pirandellienne. La comparaison de la diplomatie avec une pièce de théâtre, dans laquelle chacun joue le rôle que son gouvernement lui assigne – quand il n’en écrit tout simplement pas les dialogues (MB, pp. 44 et 82) –, vaut d’être relevée (« Une comédie », persiflait déjà Tromelin en ouverture du livre – p. 7). D’autres s’y sont déjà employés, comme Raymond Cohen, dans son remarquable ouvrage Theatre of Power : the art of diplomatic signalling. L’idée de ce dernier (que l’on retrouve en fait chez Bressant) est qu’une réunion de diplomates n’est qu’un vaste show, une mise en scène où chacun se voit assigner une posture. C’est un postulat d’ailleurs savoureusement croqué dans La dernière Conférence, où l’on trouve, pêle-mêle un idéaliste prudent (ou blasé ?) (le Tchèque), un réaliste narquois (le Finlandais), un désabusé (le Belge revenu de tout), un ogre de carnaval (le Roumain antipathique) ou encore un idéologue prêt à mourir pour ses principe (l’Est-Allemand). Sur cette scène, le verbal (par exemple, se permettre de faire une plaisanterie politiquement déplacée [6]) compte autant que le non-verbal (Milescu, le très peu commode Roumain, se contentant de brandir une pancarte pour toute réponse, montrant son refus de tout contact et, dès lors, de toute inflexion de la politique de son pays ; le « sourire homicide » d’un représentant brejnévien pur sucre ; etc.). Evidemment, le décor y déploie aussi toute son importance (la salle où se tiendront les séances de travail est profilée en forme de bateau, « comme pour notifier à ses occupants que leurs discussions doivent les conduire quelque part » [MB, p. 14] – la référence au paquebot est de surcroît amusante, quand le narrateur compare la Conférence à « une embarcation percée de partout » [ibid., p. 86]).
*
Œuvre de prime abord simplement légère quoiqu’élégamment tournée, La dernière Conférence révèle sa profondeur en cours de lecture, un peu comme l’ambassadeur Tromelin, qui découvre tous les trésors et toutes les promesses qu’une telle assemblée peut recéler. On peut ainsi pointer l’art du livre de donner vie à une faune diplomatique chamarrée – certes, non-exempte de stéréotypes –, à la planter dans un contexte spatio-temporel crédible (à défaut d’être exact au niveau factuel), en y entremêlant savamment les niveaux d’analyse systémique (lorsque le roman dépeint les tressaillements politiques du Vieux Continent) et individuel (peu ou prou, les personnalités s’identifiant à l’occasion à leurs nations – comme c’est le cas pour la « Slovéno-Yougoslave », l’Américain, le Tchèque ou les Polonais, notamment).
Nous voudrions, à titre de conclusion, mettre en lumière deux fonctions diplomatiques essentielles que le roman parvient (plus ou moins habilement) à mettre en exergue. La première, bien évidemment, est la fonction de représentation : un diplomate a pour rôle de représenter son pays à l’étranger. Certes, la représentation peut aller de pair avec des mondanités qui, de prime abord, ne paraissent que des « gestes vides » (cf. E. GOFFMAN, Les rites d’interaction, Paris, éditions de Minuit, 1974, pp. 80-81). Ces dernières font partie des clichés de la vie diplomatique, mais elles intègrent toutefois pleinement la fonction de représentation du diplomate, celui-ci en profitant pour récolter des informations, étendre son réseau ou faire passer un message. On trouve dépeintes, dans La dernière Conférence, des réceptions diplomatiques à l’occasion desquelles les liens personnels peuvent se tisser, ou un ambassadeur peut faire « promotion » de l’Etat qu’il sert (comme c’est le cas avec Hans Muller, le représentant est-allemand très fier de son pays – cf. MB, pp. 25-26). Corollaire de la fonction de représentation : la (re)tenue, le tact, le self-control apparaissent comme des vertus cardinales du diplomate (voy. D. STRUYE DE SWIELANDE, « Les qualités du diplomate moderne », in T. DE WILDE D’ESTMAEL, M. LIÉGEOIS et R. DELCORDE [dir.], La diplomatie au cœur des turbulences internationales, Louvain-la-Neuve, PUL, 2014, p. 71). Dès lors, on pourra trouver surprenantes les actions déplacées (le manque de tact, les railleries affichées, les éclats, l’impolitesse, la fumisterie) émaillant de-ci de-là les comportements de certains diplomates décrits dans le roman.
La deuxième fonction, bien évidemment, est la fonction de négociation, qui est « au cœur même de la diplomatie car elle vise à régler pacifiquement un conflit d’intérêts » (R. DELCORDE, Le métier de diplomate, 2ème éd., Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2018, v° « Négociation »). La négociation, c’est une joute, un jeu même, consistant à faire triompher de la façon la plus efficiente et indolore les intérêts de la Capitale dont relève le diplomate, en analysant les réactions de départ de ses homologues pour réagir en fonction. Négocier, précisément, ce n’est donc pas seulement, comme le note d’ailleurs ironiquement le narrateur, « s’étriper pour quelques poignées de virgules » (MB, p. 19) … Et quel écrin sert-il mieux à la grande négociation, dans le monde complexe d’aujourd’hui, que le cadre multilatéral, avec ses sommets et ses conférences aux objets les plus divers ? C’est en effet dans les enceintes multilatérales que l’action diplomatique se voit de nos jours privilégiée. On y développe, selon la jolie formule de Scheer,
« une diplomatie de proximité, de ‘club’ et – osons dire le mot – de complicité, la négociation y étant d’abord occasion de se parler, de s’écouter, de se comprendre, avant même que de s’attacher à dégager à partir d’intérêts nationaux divergents des positions communes traduites en d’innombrables textes de résolutions, règlements, directives, décisions, avis. » (F. SCHEER, « ‘Au temps du monde fini’ », in S. COHEN [dir.], op. cit. supra, p. 30)
Clairement, dans le roman – et malgré l’ennui pouvant suinter de certaines observations des protagonistes (MB, p. 52) –, la Conférence, en tant que « grande assise diplomatique » (G. SCELLE, op. cit. supra, p. 267), est présentée comme une structure de négociation propre à organiser et calmer le jeu diplomatique entre Est et Ouest, un « canal permet[tant] aux Etats de confronter leurs intérêts respectifs aux intérêts de l’ensemble » (A. REYN, « Intérêt national et multilatéralisme », in T. DE WILDE D’ESTMAEL et al., op. cit. supra, p. 189). Cela sera d’autant plus beau (quoique sans doute exagérément dépeint – cf. MB, pp. 227-231) de voir, au terme de la Conférence, fondre les intérêts nationaux, et ces derniers se recomposer autour d’intérêts communs. C’est – pour emprunter un concept à Durkheim – « l’effet de mimétisme » : dans l’enceinte de discussion s’est installée au final une « adhésion […] à l’idéal collectif de paix, de connaissance et de progrès, […] censée favoriser, à l’extérieur de la conférence, la reproduction de cet idéal d’humanité supérieure » (cité chez C. CALI, op. cit. supra, § 18). Qu’on y pense, symboliquement : une Conférence initialement prévue pour accoucher d’une Déclaration sur les échanges européens en matière d’information (un « misérable projet », selon Jean-Pierre Tromelin), s’est muée en « la première rencontre de l’Europe retrouvée » (MB, p. 230). « L’embarcation tanguant » que raillait le Français aura terminé sa croisière en beauté : en débarquant les pays d’Europe centrale et orientale dans ce port « Europe » dont ils ne se sont jamais vraiment éloignés, et en arrimant tous les passagers à un socle de valeurs et de principes que les échanges diplomatiques auront galvanisés.
*
Au final, quelle image garder, une fois La dernière Conférence refermé, des figurants qui nous ont agréablement accompagnés tout au long de notre voyage littéraire ? Des entrepreneurs d’absurdité (MB, p. 54) ? Des voyants, voire à tout le moins, des voyeurs de la grande politique (ibid., p. 181) ? Un peu de tout, sans doute… Pour citer une dernière fois François Scheer :
« Sans doute, à l’instar de toutes les professions, la diplomatie mêle-t-elle dans ses rangs grands talents et insignes médiocrités, artisans du changement et apôtres de la tradition, artistes et géomètres, croisés et sceptiques, chanceux et frustrés. Et si, plus que d’autres métiers de la fonction publique, elle suscite parfois la critique et le sarcasme, et se voit périodiquement promise à une prompte disparition, elle le doit sans doute, comme toute institution humaine, à des travers avérés mais qui ont le tort de s’afficher dans un décorum dont on se borne trop souvent à voir les paillettes, sans chercher à comprendre ce qu’il dissimule de servitudes, d’aléas et de risques » (F. SCHEER, op. cit. supra, p. 22).
[*] Assistant à l’Université libre de Bruxelles ; collaborateur scientifique au Centre de droit international de l’ULB
[1] Une réunion sous les auspices de la C.S.C.E. s’est par contre tenue à Sofia, du 16 octobre au 3 novembre 1989.
[2] Qui était, dans les faits, une réunion spécialisée faisant suite aux deux Conférences de Vienne (1986-1989), qui marquèrent une utilisation maximale des possibilités de la C.S.C.E. aux fins du rapprochement Est-Ouest, en s’intéressant à des thématiques variées comme les droits de l’homme, le désarmement conventionnel, les mesures de confiance et de sécurité, la coopération économique et la protection de l’environnement.
[3] Malgré ce que l’on peut trouver (assez étonnamment) sur des sites « spécialisés » : « La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) est une organisation internationale (sic) née pendant la Guerre Froide » (Section « Vocabulaire politique » du site du CRISP, http://www.vocabulairepolitique.be/conference-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-csce/ ; dernièrement consulté le 15 avril 2020).
[4] Après l’Acte final d’Helsinki (1975), la C.S.C.E. a tenu des conférences-bilan successives, en vue de l’application concrète des décisions prises et de progresser plus loin. Ce furent les Conférences de Belgrade (1977-80), de Madrid (1980-83), de Stockholm (1984-86), de Vienne-1 (1986-88) et de Vienne-2 (1989-90), d’Helsinki (1992), et, finalement, de Budapest (1994), qui marqua le passage de la C.S.C.E. vers l’O.S.C.E.
[5] Ce n’est qu’avec l’adoption de la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe, en 1990, que la C.S.C.E. décida de tenir des réunions régulières, à différents niveaux du politique, et d’établir un secrétariat à Prague chargé du support administratif (https://www.osce.org/fr/mc/39517?download=true), puis carrément de se doter d’un Secrétariat général (en 1992), pour améliorer son fonctionnement.
[6] Par exemple, lorsque l’un des représentants soviétiques, conservateur, évoque dans son discours devant l’assemblée « le long combat soviétique en faveur de la paix », le délégué finlandais balance « Kaboul ! Kaboul ! » (MB, p. 42).
