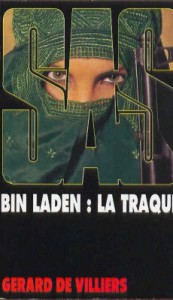 L’intrigue de ce 148ème numéro de SAS se déroule en 2002 et prend comme trame de fond l’intervention militaire des États-Unis en Afghanistan. Le roman nous permet de suivre les aventures de l’inénarrable Malko, dont la mission consiste ici en rien de moins que la capture du principal commanditaire des attentats du 11 septembre 2001. L’enquête, qu’il mènera au péril de sa vie, le conduira dans diverses régions d’Afghanistan et du Pakistan. Le roman commenté s’avère relativement riche en matériau juridique. Ces allusions au droit sont souvent le fruit des réflexions de Malko, lequel prend le soin, plusieurs fois dans le roman, de rappeler à l’un ou l’autre de ses interlocuteurs les potentielles limites juridiques de leur action.
L’intrigue de ce 148ème numéro de SAS se déroule en 2002 et prend comme trame de fond l’intervention militaire des États-Unis en Afghanistan. Le roman nous permet de suivre les aventures de l’inénarrable Malko, dont la mission consiste ici en rien de moins que la capture du principal commanditaire des attentats du 11 septembre 2001. L’enquête, qu’il mènera au péril de sa vie, le conduira dans diverses régions d’Afghanistan et du Pakistan. Le roman commenté s’avère relativement riche en matériau juridique. Ces allusions au droit sont souvent le fruit des réflexions de Malko, lequel prend le soin, plusieurs fois dans le roman, de rappeler à l’un ou l’autre de ses interlocuteurs les potentielles limites juridiques de leur action.
À l’analyse, le roman commenté aborde des problématiques d’ordre institutionnel, principalement à travers le regard que porte son auteur sur l’ONU et ses agents ; et des questions d’ordre matériel – tout particulièrement lorsqu’il est question de la mise en œuvre de certaines règles du droit international public. On mettra ainsi en lumière le contraste qui existe entre le regard, très sévère, que l’auteur porte sur l’ONU, dont l’utilité et la pertinence sont régulièrement questionnées (I) et le regard, plutôt bienveillant, que ce même auteur porte sur diverses règles substantielles du droit international dont l’existence, sinon l’effectivité, lui paraissent indéniablement acquises (II).
I. L’institution internationale méprisée
L’auteur dresse un portrait très critique, et c’est un euphémisme de le dire, de l’Organisation des Nations unies. Tout au long de l’ouvrage, l’Organisation mondiale est systématiquement dépeinte avec un mépris à peine dissimulé. Cette tendance est vérifiable tant à l’égard de l’institution – considérée en tant que telle (A) – que pour ses agents – pris isolément (B).
A. Critique de l’ONU en tant qu’institution. Au début du roman, lorsqu’il pose le cadre général de l’intrigue, le narrateur présente la région du Cachemire en soulignant que
« cette province du Nord-Est, peuplée à 90% de musulmans, avait été attribuée, par une facétie des Nations unies, par moitié à deux pays ennemis, après la seconde guerre indo-pakistanaise, en 1965 » (p. 9, italiques ajoutés).
On perçoit donc d’emblée, à travers cet extrait, le crédit limité que l’auteur paraît accorder à l’ONU. Quelques lignes plus loin, celui-ci persiste dans sa critique et va jusqu’à questionner la légitimité même de l’action des Nations unies en faveur du maintien de la paix. En effet, loin de contribuer au règlement des différends internationaux, l’Organisation aurait elle-même concouru, par l’élaboration d’un plan de « partage absurde ayant déclenché la fureur durable des Pakistanais » (p. 9), à attiser le conflit du Cachemire.
Sur le fond, la critique ici formulée est finalement assez classique dans ce qu’elle suggère sur le fonctionnement de l’Organisation mondiale. Il est en effet courant de voir celle-ci décrite comme une institution dont l’action s’avère commandée par des idéaux politiques abstraits – dont nul ne conteste qu’ils peuvent être nobles dans leur principe – mais ce au mépris ou dans l’ignorance des réalités locales ou régionales. En raison de ce décalage, l’action de l’ONU pourrait dans certains cas s’avérée inadaptée voire, à l’arrivée, contre-productive. Il faut, sur le plan factuel, faire observer que la critique formulée par le narrateur s’avère approximative, sinon inexacte. Le plan de partage dont il est question ne date pas de 1965 mais de 1948-1949 (cf. le Rapport de la Commission des Nations unies pour l’Inde et le Pakistan, S/1196, 10 janvier 1949). Loin d’avoir été imposé par l’ONU, il fut au contraire complètement approuvé par les parties intéressées au différend. Et si, au cours de l’année 1965, le Conseil de sécurité adopta effectivement cinq résolutions se rapportant au Cachemire, celles-ci portaient non pas sur le tracé de la frontière indo-pakistanaise, mais sur l’application du cessez-le-feu entre les deux belligérants (cf. en particulier la résolution 215 (1965), du 5 novembre 1965).
B. Critique des agents de l’ONU considérés individuellement. Dans le roman, les fonctionnaires de l’ONU sont, au cours de leurs rares apparitions, implacablement dépeints de façon négative. Ils sont en général désignés par le terme « Onusiens » – la majuscule étant manifestement la seule marque de déférence que l’auteur paraît concéder à cette caste. En effet, les rares fois où des fonctionnaires internationaux apparaissent, ce n’est jamais au travail mais dans l’un ou l’autre club de la capitale pakistanaise, en train de s’adonner à des loisirs souvent peu gratifiants. Ainsi, la description du club des Nations unies se résume à « sa nourriture mangeable et l’alcool qui coul[e] à flots » (p. 152). De même, au cours de ses diverses pérégrinations, le héros du roman croise « quelques Onusiens […] affalés devant un grand poste de télévision retransmettant la coupe du monde de football » et « d’autres agglutinés au bar où l’alcool coulait librement » (p. 207). Dans un autre extrait, alors que Malko discute avec son contact Pakistanais au club de l’ONU, il observe, « à la table voisine, des Coréens fêt[ant] la victoire de leur équipe de foot au Taittinger Comtes de Champagne, avec des glapissements sauvages » (p. 208). Ce portrait plutôt péjoratif paraît d’autant plus gratuit que, dans le roman, les « Onusiens » participent à densifier l’arrière-plan sans jamais jouer aucun rôle décisif dans l’intrigue. L’auteur aurait tout autant pu les présenter comme des personnages plus respectables, sans que la trame du roman en eût été aucunement altérée.
Sous la plume de l’auteur, les fonctionnaires internationaux paraissent évoluer dans un monde en décalage total avec la réalité de leur pays d’affectation. Le contraste est en effet saisissant entre l’opulence dans laquelle évoluent ces derniers et la misère régnant au Pakistan. Il en va de même de la légèreté caractérisant l’attitude des « Onusiens » – qui consacrent visiblement une bonne part de leur énergie au sport et à l’alcool – laquelle légèreté contraste avec la gravité de la situation politique et sécuritaire dans la région. L’auteur dresse en définitive un portrait des agents de l’ONU qui se nourrit volontiers du stéréotype, bien connu, de la figure du diplomate cynique, vautré dans le luxe. Cette perception se situe aux antipodes des principes de conduite prescrits par la Commission de la fonction publique internationale. Ces principes énoncent, notamment, qu’il incombe aux agents de l’ONU « de respecter les normes de conduite les plus élevées » et « d’éviter de faire preuve d’ostentation dans [leur] train de vie » (Commission de la fonction publique internationale, Normes de conduite de la fonction publique internationale, Nations unies, New York, 2013, resp. §2 et §40). On peut penser que la réalité se situe très certainement quelque part entre les deux extrêmes que sont, d’un côté, cette vision idéalisée du fonctionnaire international et, de l’autre, le portrait fortement dévalorisant des « Onusiens » dépeint dans le roman.
II. Le droit international valorisé
Dans le roman, les règles matérielles du droit international public sont évoquées par l’auteur au sujet de deux problématiques distinctes. Il s’agit de la possibilité d’assassiner un individu soupçonné de terrorisme en dehors de toute décision de justice (A) et de la possibilité d’autoriser le bombardement de bases terroristes en territoire pakistanais (B). La fiction semble ici avoir été rattrapée par la réalité. En effet, alors que ce 148ème numéro de SAS fut rédigé au cours de l’année 2002, ces deux thématiques font étonnamment écho aux controverses juridiques qui suivirent le déclenchement, en mai 2011, de l’opération « Trident de Neptune » ; opération dont on sait qu’elle a abouti au décès d’Oussama Ben Laden.
A. Le jus in bello et la question des exécutions extrajudiciaires. Dans le roman, la position des autorités américaines à l’égard du sort réservé à Oussama Ben Laden fait l’objet d’un glissement progressif. La première fois que Malko pense avoir localisé l’intéressé, la CIA envisage sa capture dans l’intention manifeste de le traduire devant un tribunal. Ainsi, lorsqu’il prend connaissance du lieu où se trouverait Oussama Ben Laden, Franck Capistrano, l’agent de liaison entre la Maison-Blanche et la CIA, s’exclame en ces termes :
« Le Président sera mis au courant dans une heure annonça-t-il. Je vous rappellerai aussitôt après, pour organiser l’opération. My God ! J’ai hâte de voir ce salaud devant un tribunal » (p. 83).
Un peu plus tard, lorsque Malko entre de nouveau en contact avec Franck Capistrano, la position du gouvernement américain paraît avoir sensiblement évolué. Dans le style très direct qui constitue sa signature, l’agent de liaison déclare : « c’est clair, […] le Président ne veut pas de cette ordure de Bin Laden vivant. Il le veut mort » (p. 87). Franck Capistrano va d’ailleurs jusqu’à écarter la possibilité de capturer Oussama Ben Laden vivant, si la possibilité se présentait. Ne laissant place à aucune équivoque, il affirme en effet qu’il « vaut mieux qu’on le capture mort que vivant » (p. 88).
Dans ce contexte, il est intéressant de s’arrêter sur la remarque formulée par Malko, à la suite de sa brève discussion avec Franck Capistrano. Le héros du roman souligne que, « d’habitude, les américains étaient plus légalistes » (p. 88, italiques ajoutés). Cette remarque n’aurait certainement pas été contredite par le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraire ; dont les travaux analysent pareilles exécutions comme une atteinte au droit à la vie, que les « situations d’urgence » ou les « menaces terroristes » ne sauraient justifier (cf. le Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, A/HRC/26/36, 1er avril 2014, § 125).
D’une façon plus générale, la remarque formulée par Malko permet de resituer le cadre de référence dans lequel entend s’inscrire le personnage principal du roman. Ainsi, bien que le respect du droit ne soit, en l’espèce, manifestement pas la priorité de la CIA, le « paramètre juridique » fait partie intégrante du processus décisionnel de ses agents. Ce n’est donc pas l’existence du droit international en tant tel qui est interrogée par l’auteur du roman, mais plutôt le problème de son effectivité. Pour le dire plus clairement, dans le monde de SAS, le droit international existe bel et bien, ce qui en soi mérite d’être souligné.
B. Le jus contra bellum et la question des actions militaires extraterritoriales. À plusieurs reprises dans le roman, les autorités américaines envisagent le déclenchement d’une intervention militaire en territoire pakistanais afin d’interpeller/éliminer Oussama Ben Laden et d’autres terroristes. La question du cadre juridique d’une telle intervention fait l’objet de plusieurs discussions entre les protagonistes du roman. Précisons, avant d’entrer dans le vif du sujet, que la conduite, par un État, d’une opération militaire unilatérale sur le territoire d’un autre État est en principe illicite. Pareille intervention – fût-elle dirigée contre des groupes terroristes et non contre les institutions de l’État sur le territoire duquel elle se déroule – ne saurait en droit international s’analyser autrement que comme une violation de l’article 2§4 de la Charte des Nations unies, lequel prohibe l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. Les développements qui suivent tenteront d’évaluer la mesure dans laquelle cette donnée juridique est prise en compte ou ignorée par les protagonistes du roman lorsqu’ils débattent d’une éventuelle intervention en territoire pakistanais.
À cet égard, un premier échange entre Malko et Franck Capistrano sur le sujet s’avère particulièrement intéressant. Lorsque le second envisage de bombarder massivement le lieu où Oussama Ben Laden serait localisé, le premier réplique :
« – Il y a quand même un petit problème […] Si Bin Laden se trouve en territoire pakistanais, que faisons-nous ? Le Pakistan est notre allié officiel…
Il y eut un silence qui se prolongea […]
– Ok, grogna le conseiller de la Maison-Blanche, dans ce cas, on emploiera des bombes « intelligentes ». Avec des F-16. Comme ça, il n’y aura pas de dégâts collatéraux.
Cela risquait quand même d’être une première : le bombardement d’un pays allié. Mais on était dans une logique de guerre…
– Bien, conclut Malko, vous êtes prévenus » (pp. 87-88).
Sur le plan juridique, il se dégage de cet extrait une certaine ambiguïté. Lorsqu’ils discutent, les deux protagonistes ne paraissent pas tout à fait parler le même langage. Alors que Malko situe assez clairement son propos dans le registre du jus contra bellum, en interrogeant la possibilité même d’agir militairement au Pakistan, Franck Capistrano répond en faisant valoir des considérations de jus in bello, en assurant son interlocuteur de son intention de faire en sorte d’éviter des « dommages collatéraux », mais en considérant le principe d’une intervention militaire comme acquis. La phrase par laquelle Malko clôt la discussion – qui sonne presque comme une mise en garde qu’un conseiller juridique pourrait formuler à l’endroit d’un gouvernement sur le point d’agir – paraît confirmer que les deux personnages s’adonnent ici, d’une certaine façon, à un dialogue de sourds.
À la fin du roman, un autre extrait mérite de retenir l’attention. Alors qu’un commando américain s’engage finalement en territoire pakistanais pour interpeller un proche acolyte d’Oussama Ben Laden, la CIA prend le soin d’embarquer, avec elle, un officier des services secrets pakistanais. L’objet de cette manœuvre est de faire en sorte que l’opération soit, formellement au moins, conduite conjointement par les forces américaines et pakistanaises. Dans ce contexte, le narrateur fait observer :
« Sur la banquette arrière de la Navigator, le major de l’ISI [*les services secrets pakistanais] était muet comme une carpe, mal à l’aise à l’idée d’intervenir contre des religieux. Heureusement ce n’était pas lui qui ferait le travail : il n’était là que pour donner un semblant de légalité à l’intervention éventuelle de la CIA » (p. 265).
De notre point de vue, cet extrait consacre bel et bien le droit international dans son existence et dans sa fonction régulatrice. En effet, c’est bien ici de la légalité de l’intervention dont il est question. Dans le cadre de leur action, et malgré la situation d’urgence, les États-Unis se contraignent au respect du droit. Cela suppose certes une part d’artifice : la présence de l’officier de l’ISI – si elle permet d’éviter que l’intervention de la CIA ne tombe sous le coup de la prohibition posée à l’article 2§4 de la Charte – s’avère purement formelle. Pourtant, et même si c’est une logique de realpolitik qui paraît commander l’action du gouvernement américain, le droit international en ressort indéniablement renforcé. En effet, les États-Unis ne paraissent pas disposés à payer le prix politique et diplomatique qu’impliquerait une intervention déclenchée au mépris du droit international.
C’est bien ce calcul rationnel, et non une foi aveugle dans les vertus du droit international, qui conduit la CIA à s’adonner à un exercice de contorsion lui permettant de faire entrer son action dans l’étroit carcan de la légalité internationale. On touche certainement ici au cœur de l’une des spécificités du droit international public, système dans lequel la crainte de la sanction sociale se substitue souvent à celle de l’authentique sanction judiciaire.
Nabil Hajjami
Maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (CEDIN)
