
Baron noir (créée en 2016 par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon) est une série télévisée française comptant actuellement trois saisons, dont la dernière a été diffusée sur Canal + au printemps 2020. Elle suit les tribulations de Philippe Rickwaert, un député-maire de Dunkerque habité par deux obsessions qui, dans le contexte de la vie politique de la fin des années 2010, paraissent contradictoires : l’Union de la gauche et, comme tout politicien français qui se respecte, la présidence de la République. Remarquablement réalisée (on a presque envie d’aller passer ses vacances à Dunkerque), émaillée par des rebondissements qui, s’ils ne sont pas toujours crédibles, nourrissent le suspense et le dynamisme de la série, émaillée de dialogues savants associant références historiques et savoureuses métaphores, Baron noir se range dans la lignée de productions comme A la Maison-Blanche (Aaron Sorkin, 1999-2006), House of Cards (Andrew Davies, 1990-1995; remake par Beau Willimon, 2013-2018) ou, plus encore, Borgen (Adam Price, 2010-2013). Bien loin de la mise en scène univoque et monochrome de l’homme politique cynique que l’on retrouve dans la version étasunienne de House of Cards autour de Frank Underwood ( v. l’analyse de Jed Odermatt dans la présente rubrique : https://cdi.ulb.ac.be/house-of-cards-season-3-international-law-and-american-power-a-review-by-jed-odermatt/), Philippe Rickwaert (Kad Merad), incarne de façon plus nuancée la tension entre la volonté de se conformer à un engagement sincère et authentique, d’une part, et la nécessité de composer avec les dures réalités de la vie et de la stratégie politique, de l’autre.

Dans ce contexte, le droit peut tantôt fournir des ressources à l’action politique, tantôt lui imposer des obstacles voire des contraintes. Les créateurs de la série ne se sont pas privés de le souligner, en centrant fort logiquement —et parfois de manière plutôt libre— leur propos sur le droit électoral français, administratif et constitutionnel. Par comparaison, le droit international n’occupe qu’une place a priori très limitée, puisque seule une scène lui est explicitement consacrée sur les 24 épisodes que comptent les trois saisons de la série. L’intensité et la richesse de cette scène est cependant remarquable. Lorsque mon savant mais aussi facétieux ami Nabil Hajjami me l’a transmise en son temps (et je ne saurais trop l’en remercier), j’ai d’abord cru à une blague, avec un argumentaire juridique tellement travaillé et pointu qu’il avait dû être ajouté en post-syncro, un peu à la manière des montages humoristiques opérés régulièrement à partir d’une scène culte de La Chute (Oliver Hirschbiegel, 2004). Mais, après plusieurs visionnages attentifs, puis découverte en confinement de l’ensemble des trois saisons de la série, j’ai bien dû me résoudre à l’évidence : Baron noir nous offre incontestablement l’un des dialogues les plus techniques en droit international de l’histoire des séries télévisées. On le comprendra aisément en prenant connaissance de l’échange reproduit ci-dessous, entre Amélie Dorendeu, la présidente de la République, et son conseiller spécial, Jacques Lambray. La scène se déroule à l’écart du tumulte des réunions politiques quotidiennes, au plus profond des sous-sols de l’Elysée, dans la salle de crise, celle-là même, signe de son extrême importance, dans laquelle on ne peut rentrer qu’en laissant son téléphone portable à l’entrée. C’est d’ailleurs en ce lieu hautement confidentiel que la présidente a été préalablement informée de la présence de trois dangereux terroristes affiliés à Daesh, qui s’apprêtaient à perpétrer de graves attentats sur le sol français. La question de la neutralisation de ces funestes personnages se pose donc de manière particulièrement urgente et dramatique. Diverses possibilités sont envisagées, dont « l’option C », la plus radicale.
- La présidente Dorendeu : « L’option C, j’ai besoin que vous m’en disiez plus ».
- Jacques Lambray : « Techniquement, la situation n’a pas évolué. L’opération reste faisable ».
- La Présidente Dorendeu: « Juridiquement, qu’est-ce qui nous autorise à exécuter un soldat de Daesh en Syrie et pas ici? ».
- Jacques Lambray : « En Syrie, c’est un peu compliqué, on s’appuie sur une interprétation extensive du droit humanitaire défini par la Charte des Nations Unies. Contrairement à la Russie qui agit dans le cadre d’un appel à l’aide d’Assad, la France est obligée de revendiquer soit la légitime défense collective, soit la légitime défense individuelle. En l’espèce, l’Irak a sollicité l’aide de la France. On considère qu’agir contre l’Etat islamique en Syrie relève de ce mandat ».
- La présidente : « Nos opérations en Syrie sont le prolongement direct de nos opérations en Irak ».
- Jacques Lambray : « Exactement, ce point n’a jamais été contesté à l’ONU ».
- La présidente : « Deuxième cas de figure ? »
- Jacques Lambray : « La légitime défense individuelle. A partir du moment où nous sommes attaqués en France par des soldats de l’Etat islamique, ça nous donne le droit de tuer des soldats de l’Etat islamique en Syrie. Par contre, attention, chaque opération doit être rigoureusement documentée pour pouvoir prouver que l’action menée là-bas est directement liée à une menace imminente ici ».
Après un bref silence où l’on voit la présidente plongée dans une intense réflexion, le conseiller juridique poursuit :
- « Sur le territoire national, c’est beaucoup plus simple, finalement. Si le danger est établi matériellement, on doit judiciariser. Dans le cas contraire… ».
- La Présidente Dorendeu : « … rien, absolument rien ! Jusqu’à ce qu’il y ait 50 morts ?! S’ils étaient en Syrie, l’ordre d’assassinat aurait été donné depuis longtemps. Maintenant qu’ils sont ici, bien plus dangereux, mille fois plus dangereux, je ne devrais rien faire ? Alors que nos forces sont exsangues, il faudrait patienter, surveiller, attendre la faute ? Où est le courage, là-dedans ? J’ai peur Jacques, j’ai peur de ne pas avoir fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que je suis la seule à pouvoir faire. J’ai peur que ça recommence ; un carnage, des enfants, chaque fois c’est plus dur. Chaque fois le pays se fissure davantage … Et moi je risque quoi exactement ? ».
- Jacques Lambray : « Avec l’option C, les Assises. Si ça venait à se savoir, le jour où vous cessez d’être présidente, vous êtes mise en examen pour assassinat ».
« Je vous ordonne de les éliminer », tranche finalement la présidente, et son ordre est aussitôt mis en œuvre dans le plus grand secret. Au cœur de la nuit, une unité d’élite de soldats français capture les trois suspects et les conduit sans ménagement dans un sombre sous-bois. C’est là, genoux en terre, qu’ils sont exécutés froidement et à bout portant, d’une balle dans la tête.

Une telle vision hante longtemps Amélie Dorendeu, et ne manque pas de provoquer chez elle quelques problèmes de conscience, même si la présidente de la République est sûre en son for intérieur d’avoir assumé pleinement ses responsabilités. Ses responsabilités, on les lui rappellera dans la suite de la série qui, sans en révéler tous les ressorts, ne manquera pas d’exploiter cet épisode à sa juste mesure dans un final haletant, voire dramatique qui, on ne le sait pas encore au moment où ces lignes sont écrites, marquera peut-être la fin de Baron noir.
Mais, au-delà des péripéties propres à l’intrigue, il n’est pas sans intérêt de souligner ici les ambiguïtés des représentations du droit international qui sont mises en scène, spécialement au regard de la pratique des exécutions extrajudiciaires ciblées (targeted killings) qui s’est développée depuis le début du siècle et a donné lieu à des doctrines juridiques novatrices, spécialement depuis l’avènement des administrations Bush puis Obama (v. O. Corten, « A la paix comme à la guerre ». Les exécutions extrajudiciaires ciblées, Paris, Pedone, à paraître). Plus particulièrement, on verra que ces ambiguïtés reflètent bien celles qui caractérisent l’action des autorités françaises dans la réalité, autorités fondamentalement tiraillées entre un discours proclamant leur foi dans la défense du droit international et leur tendance à s’en émanciper à l’occasion au nom de l’exceptionnalité d’une situation. D’un côté, la France, tout en étant en guerre contre Daesh, ne pourrait agir sur son territoire que conformément aux règles généralement applicables en temps de paix. Mais, d’un autre côté, comme on le verra ensuite, cette interprétation restrictive tend à s’effacer devant un droit, voire un devoir, de tuer.
Une interprétation restrictive du droit des conflits armés : à la guerre comme à la paix ?
A première vue, Baron noir semble défendre une interprétation du droit international particulièrement restrictive, visant à limiter les possibilités d’action contre des membres de l’Etat islamique engagés sur le territoire français pour y perpétrer une attaque pourtant présentée comme manifestement imminente. Selon Jacques Lambray, en lequel la présidente a toute confiance (il deviendra d’ailleurs Secrétaire général de l’Elysée), la France est en situation de conflit armé avec l’E.I. : « à partir du moment où nous sommes attaqués en France par des soldats de l’Etat islamique, ça nous donne le droit de tuer des soldats de l’Etat islamique en Syrie ». Le conseiller juridique exprime ici la position généralement défendue par la doctrine, selon laquelle, lorsqu’un Etat est confronté à un groupe non-étatique suffisamment organisé, dans le cadre d’hostilités atteignant une certaine permanence et une certaine intensité, on peut établir l’existence d’un conflit armé non-international (O. Corten, F. Dubuisson, V. Koutroulis et A. Lagerwall, Une introduction critique au droit international, Bruxelles, éd. U.L.B., 2017, p. 464). Dans ce contexte, les membres de ce groupe non-étatique qui sont engagés dans des activités militaires, s’ils ne sont pas d’authentiques « combattants » au sens du droit des conflits armés (ils n’ont aucun droit au statut de prisonnier de guerre, ni à l’immunité pour les actes de guerre, même lorsqu’ils viseraient des objectifs militaires), exercent ce qui a été désignée par le Comité international de la Croix rouge comme une « fonction de combat continue » (Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en DIH, 2009, pp. 36 et ss.).

Rien n’interdit donc de les considérer comme des cibles militaires et, si les nécessités militaires le justifient, de les exécuter. Dans le cas de l’Etat islamique, la doctrine majoritaire circonscrit alors le champ de bataille, au sein duquel l’ennemi peut ainsi être visé, en trois cercles concentriques : l’Irak et la Syrie, au sein duquel Daesh opère principalement, les autres territoires des Etats impliqués dans le conflit, notamment les Etats-Unis et la France, et celui des Etats tiers, qui n’ont pas engagé de combats, comme par exemple la Norvège. Selon le C.I.C.R., le droit des conflits armés devrait s’appliquer dans les relations entre l’E.I. et chaque Etat engagé dans le conflit, y compris sur le territoire de ces derniers, ce qui couvrirait donc le premier comme le deuxième cercle, mais pas le troisième (V. Koutroulis, « The Fight against Islamic State and jus in bello », Leiden Journal of International Law, 2016, pp. 827-852). Concrètement, un soldat de Daesh pourrait être visé, en Irak, en Syrie, mais aussi aux Etats-Unis ou en France ; en revanche, les Etats tiers comme la Norvège ne pourraient se prévaloir du droit des conflits armés pour viser de tels « soldats » sur leur territoire.
Dans son analyse, Jacques Lambray est plus restrictif que le C.I.C.R. lui-même, puisqu’il estime que le droit des conflits armés ne s’applique pas en France, alors même que cet Etat est bel et bien en guerre avec Daesh. Sa position s’explique sans doute par des considérations propres au droit français, lequel n’envisage des opérations militaires (spécialement sur le territoire national) que moyennant la proclamation de l’état de siège, conformément à l’article 36 de la Constitution. Là encore, on remarquera que Baron noir reflète la position prise par la France dans la réalité, puisque les opérations menées en région parisienne à la suite des attentats du 13 novembre 2015 se sont déroulées conformément aux règles qui régissent les opérations de police en temps de paix, même si elles ont été aggravées par le recours à l’état d’urgence, lequel reste un régime civil.

Quoi qu’il en soit, en se refusant par principe à appliquer le droit des conflits armés sur le territoire national tout en rappelant que la France est en guerre contre Daesh, Jacques Lambray défend une position juridique tendant à limiter drastiquement le pouvoir d’action de l’Etat. Lorsqu’elle ordonne l’exécution, la présidente Dorendeu a donc bien conscience de se placer en dehors du cadre de la légalité. La manière dont l’exécution est réalisée ne laisse d’ailleurs aucun doute à ce sujet : qu’on applique le droit international des droits humains ou le droit des conflits armés, rien ne justifie d’abattre froidement des individus alors qu’on les a déjà capturés et qu’ils sont hors d’état de nuire. Comme plusieurs personnages de la série le remarqueront, on est là devant un « assassinat » pur et simple, un « rétablissement de la peine de mort », administrée sans fondement légal, procès ni jugement, bref devant « une violation sans précédent des règles de l’Etat de droit », pour reprendre les termes utilisés par plusieurs des protagonistes à la fin de la saison 3.

Mais, à y regarder de plus près, Baron noir est loin de procéder à une défense en règle du droit international en général et du droit international humanitaire en particulier, et de condamner sur cette base les éliminations ciblées.
Une interprétation extensive du droit international : un droit ou un devoir de tuer ?
« Maintenant qu’ils sont ici, bien plus dangereux, mille fois plus dangereux, je ne devrais rien faire ? », s’insurge la présidente, lorsqu’elle apprend que le droit la réduirait à l’impuissance alors même qu’une attaque potentiellement dévastatrice est sur le point de se réaliser. Et il est difficile, comme spectatrice ou comme spectateur, de ne pas comprendre son courroux ou de ne pas partager sa frustration. Certes, et comme on l’a déjà suggéré, la présidente ne sortira pas indemne de cet épisode mais, en même temps, sa décision est plutôt présentée comme un mal nécessaire, ce que répétera d’ailleurs sans complexe et avec la faconde qu’on lui connaît le héros de la série, Philippe Rikwaert.

Dans cette perspective, que l’on retrouve dans nombre de films et séries consacrées à la guerre, le droit est dénoncé comme un frein à l’action, comme un discours formel et largement artificiel, que les adversaires ne manqueront peut-être pas d’exploiter de manière opportuniste, mais qui se révèle en réalité inadapté à l’urgence de la situation (O. Corten, « Mais où est donc passée la Charte des Nations Unies ? Représentations et sous-représentations des règles sur l’usage de la force dans les films d’action » in O. Corten et F. Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit international dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, pp. 86-129). Mais il y a plus. Le dialogue reproduit plus haut est tout entier centré sur une alternative entre l’observation stricte des règles juridiques, qui réduirait la présidente à l’impuissance, d’une part, et la mise à l’écart de ces règles au nom de motifs impérieux, de l’autre. Or, on l’a vu, le droit des conflits armés n’excluait pas de considérer les trois terroristes comme des objectifs militaires, et certainement pas de les arrêter avant qu’ils ne se livrent à une attaque. Quant au droit français, il aurait lui aussi pu être utilisé de manière parfaitement efficace et appropriée. Depuis la loi du 22 juillet 1996, plusieurs fois modifiée par la suite, le code pénal incrimine très largement des actes de participation ou de soutien au terrorisme. Et, s’agissant de la procédure pénale, les outils à disposition des services de police et de justice ont été considérablement élargis par différentes lois adoptées depuis les attentats commis à Paris en 2015 (loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme). La législation pénale française est donc devenue depuis longtemps « un outil d’anticipation permettant à la répression de s’exprimer avant que toute action terroriste soit perpétrée » (Julie Alix, « Réprimer la participation au terrorisme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2014, p. 849 ; https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2014-4-page-849.htm). L’alternative —qui est en même temps un dilemme— présentée dans Baron noir n’existe donc pas : en droit, la présidente n’était nullement tenue d’ « attendre la faute », ni réduite à ne « rien [faire], absolument rien ! » ; elle aurait parfaitement pu donner l’ordre d’appréhender les trois individus afin de les traduire devant un juge conformément au droit français et au droit international applicable (qu’il s’agisse d’ailleurs du droit des conflits armés ou du droit international des droits humains). Rien, absolument rien, ne l’obligeait à recourir à leur liquidation de sang-froid, contrairement à ce que Baron noir suggère. Cette série véhicule ainsi une représentation biaisée du droit, international comme interne, qui serait prétendument faible voire complaisant face aux activités terroristes. Le procédé est connu : en prétendant que la règle de droit paralyse, on la discrédite et on justifie à la fois sa violation en l’espèce et son remplacement de principe par des règles plus permissives encore. Une telle rhétorique se déploie fréquemment dans le domaine de la lutte antiterroriste, comme la montré François Dubuisson dans sa critique de la manière dont le droit à la vie privée était mis en scène dans la série Homeland (« Homeland 5 : une saison sous surveillance » ; https://cdi.ulb.ac.be/homeland-5-saison-surveillance-analyse-de-francois-dubuisson/).
On constate à quel point le discours juridique véhiculé ici est lourd d’ambiguïtés. On le constate encore lorsqu’on se penche sur la manière dont sont justifiées les exécutions extrajudiciaires au nom d’une « légitime défense » contre le terrorisme. Selon Jacques Lambray, en effet, une opération en Syrie pourrait être justifiée soit en tant que « prolongement direct » des actions menées en soutien de l’Irak (légitime défense collective), soit en tant que riposte aux attentats commis par l’E.I. en territoire français (légitime défense individuelle). Grâce à cette interprétation de la légitime défense, qui a été avancée par les autorités de l’administration Hollande (v. les précisions de François Alabrune, directeur des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères, « Fondements de l’intervention militaire française contre Daech en Irak et en Syrie », R.G.D.I.P., 2016, pp. 41 et ss.), la France pourrait donc agir militairement en Syrie sans le consentement de cet Etat.

Contrairement à ce qu’il avance, de tels arguments ont bel et bien été « contestés à l’ONU », la grande majorité des Etats ayant rejeté à plusieurs reprises toute interprétation extensive de la légitime défense (O. Corten, « The military operations against the ‘Islamic State’ (ISIL or Da’esh) » in T. Ruys et al. (eds.), The Use of Force in International Law. A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., 2018, pp. 873-898). Car, selon la Charte des Nations Unies telle qu’elle a été interprétée par la Cour internationale de Justice, rien n’autorise un Etat à mener des opérations militaires sur le territoire d’un autre Etat sans son consentement, à moins que ce dernier ait lui-même perpétré une agression armée contre un autre (« Appel de juristes de droit international contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorisme », R.B.D.I., 2016, pp. pp. 7 et ss. ; http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/rbdi_2016_2/RBDI_16_1_Appel%20juristes.pdf).
En l’occurrence, la Syrie n’a pas attaqué l’Irak ni un quelconque autre Etat, que ce soit de manière indirecte, ou en soutenant l’E.I. Au contraire, les forces syriennes, soutenues par la Russie, ont livré de nombreux combats contre ce groupe terroriste. On ne voit donc pas très bien au nom de quoi on pourrait franchir les frontières syriennes, sans le consentement de Damas, au nom de la lutte contre le terrorisme. A cet égard, il ne suffit pas de prétendre que la Syrie serait incapable de contrôler toutes les activités terroristes qui se déroulent sur son territoire ; si l’on suivait un tel argument, des actions militaires antiterroristes pourraient être menées à tout moment non seulement en Syrie ou en Irak, mais aussi en Afghanistan, au Pakistan, en Somalie, au Yémen, … et pourquoi pas, si l’on se réfère à des précédents comme ceux des attentats de Paris en novembre 2015, en Belgique. En bref, l’argument français fait ici écho aux interprétations extensives —et à vrai dire peu convaincantes— défendues par les Etats-Unis et ses principaux alliés.
Une exécution extrajudiciaire à la française…
« Si ça venait à se savoir, le jour où vous cessez d’être présidente, vous êtes mise en examen pour assassinat », avertit le conseiller juridique. Il n’est pas certain que son propos soit particulièrement convaincant sur le plan de la procédure, au vu de l’immunité assez large accordée à la présidente par les articles 67 et 68 de la Constitution française. Sur le fond, en revanche, il exprime assez bien le droit existant, qui ne peut qu’assimiler une exécution extrajudiciaire commise de la sorte à un « assassinat ». C’est pourquoi cet assassinat sera réalisé dans le plus grand secret, à l’instar des covert actions menées au siècle dernier qui n’étaient pas assumée officiellement, comme l’illustre notamment la pratique israélienne portée à l’écran dans Munich (Steven Spielberg, 2006). En contreplan, la série exprime bien la réticence française à assumer une doctrine officielle d’exécutions extrajudiciaires similaire à celle qu’Israël et les Etats-Unis ont proclamée depuis de début des années 2000, doctrine relayée —et en grande partie justifiée— dans les séries étasuniennes Homeland (v. notamment saison 3, épisode 1, 2013) ou House of Cards (saison 4, épisode 3, 2016), dont sont reproduites successivement deux captures d’écran.
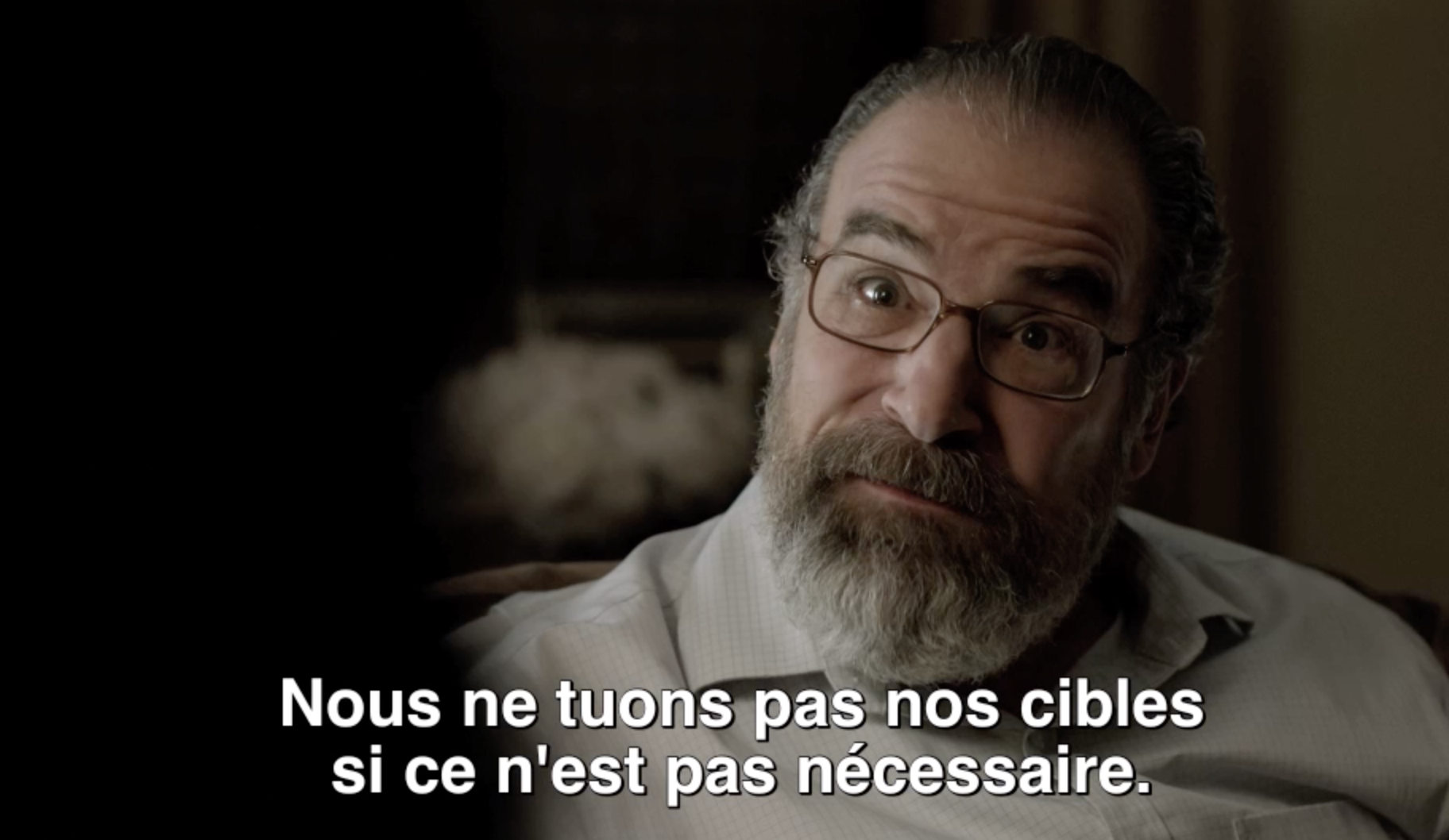

En somme, on est là devant une illustration télévisuelle de la doctrine politique et juridique française qui, de la guerre du Kosovo en 1999 à l’actuelle contre l’Etat islamique, tend à la fois à se distancier des Etats-Unis en refusant d’adhérer aux doctrines bellicistes qui se sont développées après le 11 septembre 2001 et à s’en rapprocher exceptionnellement au nom d’une situation urgente et exceptionnelle, dite parfois sui generis. En témoigne cet extrait d’un livre réalisé par deux journalistes après des dizaines d’heures d’entretien avec l’ancien président, François Hollande :
« Avez-vous ordonné des mesures de vengeance ? […]. Oui. L’armée, la DGSE, ont une liste de gens dont on peut penser qu’ils ont été responsables de prises d’otages, d’actes contre nos intérêts. On m’a interrogé, j’ai dit : ‘Si vous les appréhendez, bien sûr…’ Le chef d’Etat a l’art de ne pas dire les choses, parfois. En clair, il faut comprendre qu’il a autorisé les services secrets à assassiner des ‘ennemis d’Etat’. ‘J’en ai décidé quatre au moins’, avoue-t-il le 9 octobre 2015 lorsqu’on lui demande combien d’opérations ‘Homo’ [‘Homo’ pour ‘homicide’] il a autorisées. ‘Mais d’autres présidents en ont fait davantage’, précise-t-il aussitôt » (G. Davet, F. Lomme, Un président ne devrait pas dire ça, Paris, Stock, 2016 (chapitre 2, “La mort”).

On n’en saura pas davantage, pour des raisons évidentes de confidentialité mais aussi parce que, officiellement, la France s’est toujours refusée à assumer une doctrine officielle d’éliminations ciblées. Décidément, et ce n’est pas son moindre intérêt, Baron noir illustre assez bien à l’écran les spécificités françaises de la pratique des exécutions extrajudiciaires et les ambiguïtés politiques et juridiques que cette pratique suscite
[*] Tous mes plus vifs remerciements à François Dubuisson, Nabil Hajjami, Vaios Koutroulis et Diane Roman pour leurs commentaires et suggestions qui ont permis une amélioration substantielle de ce texte.
