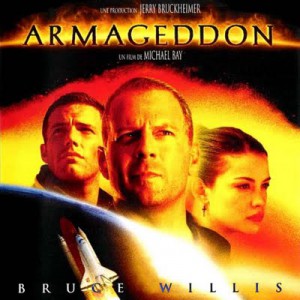 Un monstrueux astéroïde file droit sur la Terre et menace l’humanité tout entière. Harry (Bruce Willis) et son équipe sont recrutés et formés par la NASA pour aller à la rencontre de l’astéroïde et le faire exploser en y implantant plusieurs charges nucléaires.
Un monstrueux astéroïde file droit sur la Terre et menace l’humanité tout entière. Harry (Bruce Willis) et son équipe sont recrutés et formés par la NASA pour aller à la rencontre de l’astéroïde et le faire exploser en y implantant plusieurs charges nucléaires.
On passera sur les invraisemblances scientifiques pleinement assumées, sur la couche dégoulinante de patriotisme bon marché et sur l’habituel grand cœur cynique et bourru incarné par Bruce Willis. Armageddon est un film d’action et de science-fiction, certes, mais il traduit à plus d’un égard un certain sentiment américain vis-à-vis de la communauté internationale, alors même que l’humanité fait face à son destin immédiat.
Un point commun à bien des films de catastrophe hollywoodiens est le fait que, même au cœur de l’Apocalypse, le monde se réduit forcément aux Etats-Unis d’Amérique. Dans quelques scènes de ces films, on évoque bien le destin tragique d’autres villes du globe (rarement des pays), qui ne survivent quasiment jamais au cataclysme. Mais la tendance est de réduire le champ narratif au territoire américain.
Il n’y a là rien de bien extraordinaire : la fin du monde n’a de sens que dans la mesure où elle signifie ma fin et celle de mes proches, la fin de ce que je connais et de ce que je vis. Mais cette attitude n’est pas sans conséquence ; la réaction du spectateur dans les salles obscures est similaire à celle de l’électeur dans l’isoloir : mon monde d’abord, le reste ensuite.
Comment, dès lors, parler d’une vision, positive ou négative, de la coopération internationale dans Armageddon ? Il n’y en a aucune. Tout simplement parce que, face à la fin de l’humanité, les Etats-Unis sont seuls : seuls victimes, seuls sauveurs. Peut-on pour autant parler d’une vision tronquée de la réalité ? La réponse est nuancée.
L’énergie nucléaire : entre course aux armements et nécessité technique
« – Why don’t we just
send up a hundred and
fifty nuclear warheads and
blast that rock apart?
– Terrible idea.
– Was I talkin’ to you? »
Illustration symptomatique de la vision hégémonique américaine : l’utilisation de l’énergie nucléaire. Pour sauver la Terre, la NASA prend la décision d’envoyer dans l’espace plusieurs bombes à hydrogène afin de faire exploser l’astéroïde (à noter que des étudiants en physique de l’Université de Leicester se sont amusés à calculer que la masse nécessaire à réaliser l’exploit en question représenterait en réalité un milliard de fois celle de Big Ivan, la plus puissante bombe jamais testée sur terre). Le but est louable et le propos sans bellicisme aucun. Cependant, c’est oublier un peu vite que l’utilisation d’énergie nucléaire dans l’espace est encadrée par des recommandations techniques internationales, dont celles édictées par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en 1992. Il n’est pas question ici d’armes de destruction massive (explicitement prohibées par le Traité sur les principes régissant les activités des Etat en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, du 27 janvier 1967). Cependant, l’emport de charges nucléaires par un engin spatial, quelquefois nécessaire pour des missions d’exploration lointaine, n’est pas une opération dénuée de risques.
Un espace de découvertes, un espace d’idées
« – Well, technically, patents don’t apply to outer space
– Just shut up, Quincy. »
Seule concession du film à la réalité juridique de l’espace : le coup du brevet. Dans le récit, Harry et ses équipiers sont engagés car Harry est le seul à pouvoir actionner un appareil de forage sur lequel il détient un brevet. Lorsque la NASA lui révèle qu’elle a tenté, sans succès, d’utiliser son invention, Harry proteste en faisant valoir ses droits de paternité intellectuelle. Il s’entend répondre que « techniquement, les brevets ne s’appliquent pas à l’espace extra-atmosphérique ».
Cette affirmation est intéressante et discutable. Elle semble reposer sur le fait que, par nature, les brevets sont des titres de propriété intellectuelle ayant une portée territoriale. Or, le droit international prohibe toute extension de souveraineté internationale sur l’espace extra-atmosphérique. Il n’est donc pas possible, en principe, de faire valoir l’application d’une loi nationale – et donc d’un droit subjectif dérivé – en un point quelconque de l’espace. La situation est différente pour les objets spatiaux : ceux-ci doivent, en vertu du droit international, être immatriculés par leur Etat de lancement. Cette immatriculation a pour effet d’étendre à l’objet et à son bord le contrôle et la juridiction de l’Etat. Une telle extension n’est toutefois pas un agrandissement du territoire de l’Etat. La question de l’application de la protection conférée par les brevets à bord des engins spatiaux n’était donc pas résolue pour autant, jusqu’à ce qu’en 1990, les Etats-Unis adoptent une disposition spécifique de l’US Patent Act qui prévoit que toute invention faite, utilisée ou vendue à bord d’un engin spatial immatriculé par les Etats-Unis est réputée être faite, utilisée ou vendue sur le sol américain. Les événements du film étant censés se dérouler entre 1997 et 1998, les scénaristes ne pouvaient ignorer cette disposition.
Une Amérique mondiale, entre bons sentiments et besoin de dominance
« – Look, they’re the best at what they do.
– So am I. And I’m not so optimistic.
We spend 250 billion dollars a year on defense.
And here we are.
The fate of the planet is in the hands of a bunch of retards
I wouldn’t trust with a potato gun. »
Au-delà de ces quelques imprécisions, voire invraisemblances, vite pardonnées par l’amateur de sensations fortes, Armageddon offre l’image d’une Amérique de héros et d’anti-héros. Il traduit ce fantasme, depuis si longtemps ancré dans la culture américaine, de se poser en sauveurs de l’humanité, tout en ne devant rien à personne. Et cette attitude se réplique à l’échelle individuelle, dans le personnage-même incarné par Bruce Willis, qui vomit les bureaucrates, mais acceptent de coopérer avec eux face au péril. Peut-être parce que, derrière ce voile de cynisme et cette fronde, il y a encore quelques bribes de respect pour les institutions du Nouveau Monde et ce qu’elles ont accompli.
Cet « individualisme collectif » explique en partie les profondes divergences culturelles entre Américains et Européens quant à l’approche du droit international et de la solution multilatérale. Qui négocie dans les instances intergouvernementales a quelquefois le sentiment que, lorsque le Vieux Continent cherche une entente internationale sur laquelle il pourra greffer une politique de mise en œuvre, les Etats-Unis, eux, voient dans cette entente le moyen de « boucher les trous » de leur politique nationale (voire, dans certains cas, de fournir au Président un prétexte pour éconduire un Congrès qui lui est antipathique).
Il ne faudrait pourtant pas verser dans la caricature : si la conception que le juge et le citoyen américains se sont faite du droit international peut quelquefois prêter à sourire (ce beau cas de la vente de parcelle lunaires ou martiennes sur internet, ou encore la reconnaissance du droit d’inclure les orbites dans les revendications d’un brevet), il ne faut pas oublier que le principe de la primauté essentielle du droit international sur le droit constitutionnel interne est encore loin d’être unanimement accepté par bon nombre de juridictions supérieures d’Etats européens, voire de l’Union européenne elle-même (voyez les discussions au sujet de l’Article 223 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne). Mauvaise posture pour donner des leçons…
 Par ailleurs, même si les Américains affichent une méfiance face au multilatéralisme, ils n’en demeurent pas moins des modèles d’avant-garde dans bien des domaines : quel visiteur n’a pas été impressionné par leur capacité à protéger les grandes réserves naturelles sur leur territoire, alors même qu’il leur est si difficile d’accepter le Protocole de Kyoto ? En matière de limitation des débris spatiaux, les standards américains sont la référence technique, alors même que les Etats-Unis refusent toute norme internationale dans ce domaine. L’US Air Force est de très loin le plus gros contributeur à la surveillance du trafic orbital : plus que n’importe quel autre pays, les Etats-Unis pâtissent de la surpopulation satellitaire. Mais il semble qu’ils aient plus à perdre encore d’un nouveau traité limitant leur utilisation de l’espace.
Par ailleurs, même si les Américains affichent une méfiance face au multilatéralisme, ils n’en demeurent pas moins des modèles d’avant-garde dans bien des domaines : quel visiteur n’a pas été impressionné par leur capacité à protéger les grandes réserves naturelles sur leur territoire, alors même qu’il leur est si difficile d’accepter le Protocole de Kyoto ? En matière de limitation des débris spatiaux, les standards américains sont la référence technique, alors même que les Etats-Unis refusent toute norme internationale dans ce domaine. L’US Air Force est de très loin le plus gros contributeur à la surveillance du trafic orbital : plus que n’importe quel autre pays, les Etats-Unis pâtissent de la surpopulation satellitaire. Mais il semble qu’ils aient plus à perdre encore d’un nouveau traité limitant leur utilisation de l’espace.
L’espace extra-atmosphérique n’est plus épargné aujourd’hui par ce dilemme permanent entre souveraineté et mondialisation, entre culturalisme identitaire et globalisme virtuel. Les fruits de l’exploration et de l’utilisation de l’espace ont tendance à perdre en prestige ce qu’ils gagnent en valeur marchande. Le « bip » d’un satellite ne fait plus vibrer grand monde, si ce n’est par le biais des téléphones portables et des marchés colossaux liés aux applications spatiales. L’espace permet à la civilisation de sortir de son corps, de se projeter en hauteur et de se découvrir telle qu’elle est, vue par l’immensité d’un vide froid et neutre. Mais cela ne signifie pas que nous en tirions les enseignements.
Armageddon exploite la peur fondamentale de l’être humain : celle de disparaître dans l’indifférence, sans postérité, sans trace, sans regret. Cette peur est la raison, consciente ou inconsciente, pour laquelle nous réalisons tant de choses, grandioses ou abominables. Cette peur est à l’origine du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui et dont l’un des ciments est le droit international.
Jean-François Mayence
Responsable de la Cellule juridique
« Relations internationales »
BELSPO (Politique scientifique fédérale)
Praktijklector KU Leuven
